Auteur: Alex Gladstein | Date Originale: 30/11/22 |Traduit par: Sovereign Monk | Bitcoin Magazine
I. Les Champs De Crevettes
"Tout est parti."
- Kolyani Mondal
Il y a 52 ans, le cyclone Bhola a tué environ 1 million de personnes sur la côte du Bangladesh. C'est, à ce jour, le cyclone tropical le plus meurtrier de l'histoire. Les autorités locales et internationales connaissaient bien les risques catastrophiques de telles tempêtes : dans les années 1960, les responsables régionaux avaient construit un réseau massif de digues pour protéger le littoral et ouvrir davantage de territoires à l'agriculture. Mais dans les années 1980, après l'assassinat du leader indépendantiste Sheikh Mujibur Rahman, l'influence étrangère a poussé un nouveau régime autocratique bangladais à changer de cap. Le souci de la vie humaine a été écarté et la protection de la population contre les tempêtes a été affaiblie, tout cela dans le but de stimuler les exportations pour rembourser la dette.
Au lieu de renforcer les forêts de mangroves locales qui protégeaient naturellement le tiers de la population vivant près de la côte, et au lieu d'investir dans la culture de denrées alimentaires pour nourrir une nation en pleine expansion, le gouvernement a contracté des prêts auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international afin de développer l'élevage de crevettes. Le processus d'aquaculture - contrôlé par un réseau de riches élites liées au régime - consistait à pousser les agriculteurs à contracter des prêts pour "améliorer" leur exploitation en perçant des trous dans les digues qui protégeaient leurs terres de l'océan, remplissant d'eau salée leurs champs autrefois fertiles. Ensuite, ils devaient travailler pendant des heures épuisantes pour récolter à la main les jeunes crevettes dans l'océan, les ramener dans leurs étangs stagnants et vendre les crevettes adultes aux seigneurs locaux de la crevette.
Grâce au financement de la Banque mondiale et du FMI, d'innombrables fermes, ainsi que les zones humides et les forêts de mangrove qui les entourent, ont été transformées en étangs à crevettes appelés "ghers". Le delta du Gange est un endroit incroyablement fertile qui abrite les Sundarbans, la plus grande étendue de forêt de mangrove du monde. Mais l'élevage commercial de crevettes étant devenu la principale activité économique de la région, 45% des mangroves ont été rasées, laissant des millions de personnes exposées aux vagues de 10 mètres qui peuvent s'abattre sur la côte lors des grands cyclones. Les terres arables et la vie fluviale ont été lentement détruites par l'excès de salinité provenant de la mer. Des forêts entières ont disparu car l'élevage de crevettes a tué une grande partie de la végétation de la région, "transformant cette terre autrefois généreuse en un désert d'eau", selon le Partenariat pour le développement côtier.

Les seigneurs de la crevette, eux, ont fait fortune, et la crevette (connu sous le nom de "or blanc") est devenue la deuxième plus grande exportation du pays. En 2014, plus de 1,2 million de Bangladais travaillaient dans l'industrie de la crevette, et 4,8 millions de personnes en dépendaient indirectement, soit environ la moitié des pauvres de la côte. Les collecteurs de crevettes, qui ont le travail le plus difficile, représentent 50 % de la main-d'œuvre mais ne voient que 6% des bénéfices. Trente pour cent d'entre eux sont des filles et des garçons engagés dans le travail des enfants, qui travaillent jusqu'à neuf heures par jour dans l'eau salée, pour moins d'un dollar par jour, et dont beaucoup ont abandonné l'école et restent analphabètes pour le faire. Des protestations contre l'expansion de l'élevage de crevettes ont eu lieu, mais elles ont été violemment réprimées. Dans un cas bien connu, une marche a été attaquée à l'explosif par les propriétaires de crevettes et leurs voyous, et une femme nommée Kuranamoyee Sardar a été décapitée.
Dans un document de recherche de 2007, 102 fermes de crevettes bangladaises ont été étudiées, révélant que, sur un coût de production de 1 084 dollars par hectare, le revenu net était de 689 dollars. Les profits du pays, axés sur l'exportation, ont été réalisés au détriment des crevettiers, dont les salaires ont été dévalués et l'environnement détruit.
Dans un rapport de l'Environmental Justice Foundation, une agricultrice de la côte nommée Kolyani Mondal a déclaré qu'elle "cultivait du riz et élevait du bétail et de la volaille", mais qu'après l'imposition de la pêche à la crevette, "son bétail et ses chèvres ont développé une maladie de type diarrhée et, avec ses poules et ses canards, sont tous morts".
Aujourd'hui, ses champs sont inondés d'eau salée, et ce qui reste est à peine productif : il y a quelques années, sa famille pouvait produire "18-19 mon de riz par hectare", mais aujourd'hui, elle ne peut en produire qu'un seul. Elle se souvient que l'élevage de crevettes dans sa région a commencé dans les années 1980, lorsque l'on a promis aux villageois des revenus plus importants ainsi que de la nourriture et des récoltes en abondance, mais maintenant "tout a disparu". Les éleveurs de crevettes qui utilisent ses terres avaient promis de lui verser 140 dollars par an, mais elle dit qu'elle ne reçoit au mieux que "des versements occasionnels de 8 dollars ici ou là". Dans le passé, dit-elle, "la famille tirait de la terre la plupart des choses dont elle avait besoin, mais maintenant il n'y a plus d'autres solutions que d'aller au marché pour acheter de la nourriture."
Au Bangladesh, des milliards de dollars de prêts "d'ajustement structurel" de la Banque mondiale et du FMI - ainsi nommés pour la façon dont ils obligent les nations emprunteuses à modifier leur économie pour favoriser les exportations au détriment de la consommation - ont fait passer les bénéfices nationaux de la crevette de 2,9 millions de dollars en 1973 à 90 millions de dollars en 1986, puis à 590 millions de dollars en 2012. Comme dans la plupart des cas avec les pays en développement, les revenus ont été utilisés pour le service de la dette extérieure, le développement des actifs militaires et pour remplir les poches des responsables gouvernementaux. Quant aux serfs crevettiers, ils ont été appauvris : moins libres, plus dépendants et moins capables de se nourrir qu'avant. Pour ne rien arranger, des études montrent que "les villages protégés de la marée de tempête par des forêts de mangroves connaissent nettement moins de décès" que les villages dont les protections ont été supprimées ou endommagées.
Sous la pression de l'opinion publique, en 2013, la Banque mondiale a prêté 400 millions de dollars au Bangladesh pour tenter d'inverser les dégâts écologiques. En d'autres termes, la Banque mondiale recevra une rémunération sous forme d'intérêts pour tenter de régler le problème qu'elle a créé en premier lieu. Entre-temps, la Banque mondiale a prêté des milliards à des pays allant de l'Équateur, au Maroc, au l'Inde pour remplacer l'agriculture traditionnelle par la production de crevettes.
La Banque mondiale affirme que le Bangladesh est "une histoire remarquable de réduction de la pauvreté et de développement". Sur le papier, la victoire est déclarée : des pays comme le Bangladesh ont tendance à afficher une croissance économique au fil du temps, leurs exportations augmentant pour faire face à leurs importations. Mais les recettes d'exportation profitent surtout à l'élite dirigeante et aux créanciers internationaux. Après dix ajustements structurels, la dette du Bangladesh a augmenté de manière exponentielle, passant de 145 millions de dollars en 1972 à un record absolu de 95,9 milliards de dollars en 2022. Le pays est actuellement confronté à une nouvelle crise de la balance des paiements et, ce mois-ci, il a accepté de contracter son onzième prêt auprès du FMI, cette fois un renflouement de 4,5 milliards de dollars, en échange de nouveaux ajustements. La Banque et le Fonds prétendent vouloir aider les pays pauvres, mais le résultat clair après plus de 50 ans de leurs politiques est que des nations comme le Bangladesh sont plus dépendantes et endettées que jamais.
Dans les années 1990, à la suite de la crise de la dette du tiers-monde, la Banque et le Fonds ont fait l'objet d'un examen public mondial : études critiques, manifestations de rue et conviction générale et bipartite (même dans les couloirs du Congrès américain) que ces institutions allaient du gaspillage à la destruction. Mais ce sentiment et cet intérêt se sont largement estompés. Aujourd'hui, la Banque et le Fonds parviennent à garder un profil bas dans la presse. Lorsqu'ils sont évoqués, ils sont généralement considérés comme de moins en moins pertinents, acceptés comme problématiques mais nécessaires, ou même accueillis comme utiles.
La réalité est que ces organisations ont appauvri et mis en danger des millions de personnes, enrichi des dictateurs et des kleptocrates et mis de côté les droits de l'homme pour générer un flux de plusieurs milliards de dollars de nourriture, de ressources naturelles et de main-d'œuvre bon marché des pays pauvres vers les pays riches. Leur comportement dans des pays comme le Bangladesh n'est pas une erreur ou une exception : c'est leur façon préférée de faire des affaires.
II. La Banque Mondiale et Le FMI
"Rappelons-nous que le but principal de l'aide n'est pas d'aider les autres nations mais de nous aider nous-mêmes."
- Richard Nixon
Le FMI est le prêteur international de dernier recours et la Banque mondiale est la plus grande banque de développement du monde. Ils effectuent leur travail pour le compte de leurs principaux créanciers, qui sont historiquement les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Japon.

Les organisations sœurs - physiquement réunies à leur siège à Washington, DC - ont été créées à la conférence de Bretton Woods, dans le New Hampshire, en 1944, en tant que deux piliers du nouvel ordre monétaire mondial dirigé par les États-Unis. Selon la tradition, la Banque mondiale est dirigée par un Américain, et le FMI par un Européen.
Leur objectif initial était d'aider à reconstruire l'Europe et le Japon déchirés par la guerre, la Banque se concentrant sur des prêts spécifiques pour des projets de développement et le Fonds s'occupant des problèmes de balance des paiements par le biais de "renflouements" afin de maintenir le flux des échanges commerciaux même si les pays ne pouvaient pas se permettre d'augmenter leurs importations.
Les pays sont tenus d'adhérer au FMI pour avoir accès aux "avantages" de la Banque mondiale. Aujourd'hui, il y a 190 États membres : chacun d'entre eux a déposé un mélange de sa propre monnaie et de "monnaie forte" (généralement des dollars, des monnaies européennes ou de l'or) lors de son adhésion, créant ainsi une réserve.
Lorsque les membres rencontrent des problèmes chroniques de balance des paiements et ne peuvent pas rembourser leurs prêts, le Fonds leur offre des crédits provenant du pool à des multiples variables de ce qu'ils ont initialement déposé, à des conditions de plus en plus onéreuses.
Le Fonds est techniquement une banque centrale supranationale, car depuis 1969, il frappe sa propre monnaie : les droits de tirage spéciaux (DTS), dont la valeur est basée sur un panier des principales devises du monde. Aujourd'hui, le DTS est adossé à 45% de dollars, 29% d'euros, 12% de yuans, 7% de yens et 7% de livres. La capacité totale de prêt du FMI s'élève aujourd'hui à 1000 milliards de dollars.
Entre 1960 et 2008, le Fonds s'est surtout attaché à aider les pays en développement en leur accordant des prêts à court terme assortis de taux d'intérêt élevés. Les monnaies émises par les pays en développement n'étant pas librement convertibles, elles ne peuvent généralement pas être échangées contre des biens ou des services à l'étranger. Les pays en développement doivent donc gagner des devises fortes grâce à leurs exportations. Contrairement aux États-Unis, qui peuvent simplement émettre la monnaie de réserve mondiale, des pays comme le Sri Lanka et le Mozambique sont souvent à court d'argent. À ce moment-là, la plupart des gouvernements - en particulier les gouvernements autoritaires - préfèrent la solution rapide qui consiste à emprunter au Fonds pour assurer l'avenir de leur pays.
Quant à la Banque, elle déclare que sa mission est de fournir des crédits aux pays en développement pour "réduire la pauvreté, accroître la prospérité partagée et promouvoir le développement durable." La Banque elle-même est divisée en cinq parties, allant de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui se concentre sur les prêts "fermes" plus traditionnels aux grands pays en développement (pensez au Brésil ou à l'Inde), à l'Association internationale de développement (IDA), qui se concentre sur les prêts "souples" sans intérêt avec de longs délais de grâce pour les pays les plus pauvres. La BIRD gagne de l'argent en partie grâce à l'effet Cantillon : elle emprunte à des conditions favorables auprès de ses créanciers et des acteurs du marché privé qui ont un accès plus direct à des capitaux moins chers, puis elle prête ces fonds à des conditions plus élevées aux pays pauvres qui n'ont pas cet accès.
Les prêts de la Banque mondiale sont traditionnellement axés sur des projets ou des secteurs spécifiques et visent à faciliter l'exportation de matières premières (par exemple, en finançant les routes, les tunnels, les barrages et les ports nécessaires à l'extraction des minerais et à leur commercialisation sur les marchés internationaux) et à transformer l'agriculture de consommation traditionnelle en agriculture industrielle ou en aquaculture, afin que les pays puissent exporter davantage de denrées alimentaires et de biens vers l'Occident.
Les États membres de la Banque et du Fonds n'ont pas de droit de vote en fonction de leur population. L'influence a plutôt été conçue il y a sept décennies pour favoriser les États-Unis, l'Europe et le Japon par rapport au reste du monde. Cette domination ne s'est que légèrement affaiblie ces dernières années.
Aujourd'hui, les États-Unis détiennent toujours, et de loin, la plus grande part des voix, avec 15,6 % de la Banque et 16,5 % du Fonds, ce qui leur permet d'opposer leur veto à toute décision importante, qui requiert 85 % des voix dans chaque institution. Le Japon possède 7,35 % des voix à la Banque et 6,14 % au Fonds ; l'Allemagne 4,21 % et 5,31 % ; la France et le Royaume-Uni 3,87 % et 4,03 % chacun ; et l'Italie 2,49 % et 3,02 %.
En revanche, l'Inde, avec ses 1,4 milliard d'habitants, ne dispose que de 3,04 % des voix à la Banque et de 2,63 % au Fonds : moins de pouvoir que son ancien maître colonial, malgré une population 20 fois plus importante. Les 1,4 milliard d'habitants de la Chine obtiennent 5,7 % à la Banque et 6,08 % au Fonds, soit à peu près la même part que les Pays-Bas, plus le Canada et l'Australie. Le Brésil et le Nigeria, les plus grands pays d'Amérique latine et d'Afrique, ont à peu près le même poids que l'Italie, une ancienne puissance impériale en plein déclin.
La petite Suisse, qui ne compte que 8,6 millions d'habitants, dispose de 1,47 % des voix à la Banque mondiale et de 1,17 % des voix au FMI, soit à peu près la même proportion que le Pakistan, l'Indonésie, le Bangladesh et l'Éthiopie réunis, bien que leur population soit 90 fois moins nombreuse.
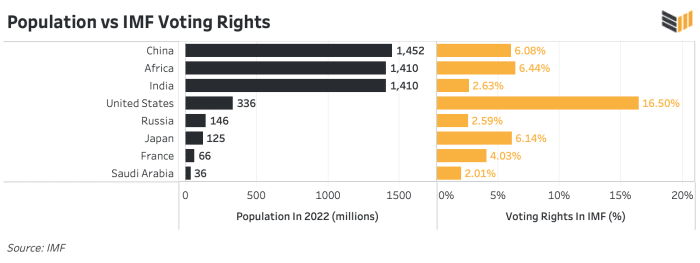
Ces parts de vote sont censées représenter approximativement la part de chaque pays dans l'économie mondiale, mais leur structure datant de l'époque impériale contribue à colorer la façon dont les décisions sont prises. Soixante-cinq ans après la décolonisation, les puissances industrielles dirigées par les États-Unis continuent d'exercer un contrôle plus ou moins total sur le commerce et les prêts mondiaux, tandis que les pays les plus pauvres n'ont en fait aucune voix.
Le G-5 (États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni et France) domine le conseil d'administration du FMI, même s'il ne représente qu'un pourcentage relativement faible de la population mondiale. Le G-10 plus l'Irlande, l'Australie et la Corée représentent plus de 50 % des voix, ce qui signifie qu'avec un peu de pression sur ses alliés, les États-Unis peuvent prendre des décisions, même sur des décisions de prêt spécifiques, qui nécessitent une majorité.
Pour compléter le pouvoir de prêt de mille milliards de dollars du FMI, le groupe de la Banque mondiale revendique plus de 350 milliards de dollars de prêts en cours dans plus de 150 pays. Ce crédit a connu un pic au cours des deux dernières années, les organisations sœurs ayant prêté des centaines de milliards de dollars aux gouvernements qui ont verrouillé leurs économies en réponse à la pandémie de COVID-19.
Au cours des derniers mois, la Banque et le Fonds ont commencé à orchestrer des opérations d'un milliard de dollars pour "sauver" des gouvernements mis en danger par les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Ces clients sont souvent des violateurs des droits de l'homme qui empruntent sans la permission de leurs citoyens, lesquels seront en fin de compte responsables du remboursement du principal et des intérêts des prêts. Le FMI renfloue actuellement le dictateur égyptien Abdel Fattah El-Sisi - responsable du plus grand massacre de manifestants depuis la place Tiananmen - par exemple, avec 3 milliards de dollars. Pendant ce temps, la Banque mondiale déboursait, au cours de l'année écoulée, un prêt de 300 millions de dollars à un gouvernement éthiopien qui commettait un génocide au Tigré.
L'effet cumulé des politiques de la Banque et du Fonds est bien plus important que le montant papier de leurs prêts, car ce sont ces derniers qui déterminent l'aide bilatérale. On estime que "chaque dollar fourni au tiers monde par le FMI débloque quatre à sept dollars supplémentaires de nouveaux prêts et de refinancement de la part des banques commerciales et des gouvernements des pays riches". De même, si la Banque et le Fonds refusent de prêter à un pays donné, le reste du monde suit généralement le mouvement.
Il est difficile de surestimer l'impact considérable que la Banque et le Fonds ont eu sur les pays en développement, en particulier au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. En 1990 et à la fin de la guerre froide, le FMI avait accordé des crédits à 41 pays d'Afrique, 28 pays d'Amérique latine, 20 pays d'Asie, huit pays du Moyen-Orient et cinq pays d'Europe, touchant ainsi 3 milliards de personnes, soit ce qui était alors les deux tiers de la population mondiale. La Banque mondiale a accordé des prêts à plus de 160 pays. Elles restent les institutions financières internationales les plus importantes de la planète.
III. L'Ajustement Structurel
"L'ajustement est une tâche toujours nouvelle et sans fin".
- Otmar Emminger, ancien directeur du FMI et créateur du DTS
Aujourd'hui, les titres des journaux financiers sont remplis d'histoires sur les visites du FMI dans des pays comme le Sri Lanka et le Ghana. Le résultat est que le Fonds prête des milliards de dollars aux pays en crise en échange de ce que l'on appelle un ajustement structurel.
Dans le cadre d'un prêt pour ajustement structurel, les emprunteurs ne doivent pas seulement rembourser le principal plus les intérêts : ils doivent également accepter de modifier leur économie en fonction des exigences de la Banque et du Fonds. Ces exigences stipulent presque toujours que les clients doivent maximiser les exportations au détriment de la consommation intérieure.
Au cours de ses recherches pour cet essai, l'auteur a beaucoup appris du travail de Cheryl Payer, spécialiste du développement, qui a écrit des livres et des articles qui ont fait date sur l'influence de la Banque et du Fonds dans les années 1970, 1980 et 1990. L'auteur peut ne pas être d'accord avec les "solutions" de Payer - qui, comme celles de la plupart des critiques de la Banque et du Fonds, tendent à être socialistes - mais de nombreuses observations qu'elle fait sur l'économie mondiale restent vraies quelle que soit l'idéologie.
"C'est un objectif explicite et fondamental des programmes du FMI", écrit-elle, "de décourager la consommation locale afin de libérer des ressources pour l'exportation."
On n'insistera jamais assez sur ce point.
Le récit officiel est que la Banque et le Fonds ont été conçus pour "favoriser une croissance économique durable, promouvoir des niveaux de vie plus élevés et réduire la pauvreté." Mais les routes et les barrages construits par la Banque ne sont pas destinés à améliorer les transports et l'électricité pour les populations locales, mais plutôt à faciliter l'extraction de richesses par les multinationales. Et les renflouements accordés par le FMI ne visent pas à "sauver" un pays de la faillite - ce qui serait probablement la meilleure chose pour lui dans de nombreux cas - mais plutôt à lui permettre de payer sa dette avec encore plus de dette, afin que le prêt initial ne se transforme pas en un trou dans le bilan d'une banque occidentale.
Dans ses livres sur la Banque et le Fonds, Mme Payer décrit comment ces institutions prétendent que la conditionnalité de leurs prêts permet aux pays emprunteurs "d'atteindre une balance commerciale et des paiements plus saine." Mais le véritable objectif, dit-elle, est "de soudoyer les gouvernements pour les empêcher de procéder aux changements économiques qui les rendraient plus indépendants et autosuffisants." Lorsque les pays remboursent leurs prêts d'ajustement structurel, le service de la dette est prioritaire, et les dépenses intérieures doivent être "ajustées" à la baisse.
Les prêts du FMI étaient souvent alloués par le biais d'un mécanisme appelé "accord de confirmation", une ligne de crédit qui ne libérait les fonds que si le gouvernement emprunteur déclarait atteindre certains objectifs. De Djakarta à Lagos en passant par Buenos Aires, le personnel du FMI prenait l'avion (toujours en première classe ou en classe affaires) pour rencontrer des dirigeants non démocratiques et leur offrir des millions ou des milliards de dollars en échange de la mise en œuvre de leur plan économique.
Les demandes typiques du FMI sont les suivantes:
- Dévaluation de la monnaie
- Abolition ou réduction des contrôles des changes et des importations
- Réduction du crédit bancaire national
- Augmentation des taux d'intérêt
- Augmentation des taxes
- Fin des subventions à la consommation pour l'alimentation et l'énergie
- Plafonnement des salaires
- Restriction des dépenses publiques, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation.
- Conditions juridiques favorables et incitations pour les multinationales
- La vente d'entreprises d'État et de droits sur les ressources naturelles à des prix de dumping.
La Banque mondiale avait également son propre livre de jeu. Payer en donne des exemples:
- Le désenclavement de régions auparavant isolées grâce à des investissements dans Les transports et les télécommunications
- L'aide aux multinationales dans le secteur minier
- Insister sur la production pour l'exportation
- La pression exercée sur les emprunteurs pour qu'ils améliorent les privilèges juridiques relatifs aux obligations fiscales des investissements étrangers
- S'opposer aux lois sur le salaire minimum et à l'activité syndicale
- Mettre fin aux protections des entreprises locales
- Financer des projets qui s'approprient les terres, l'eau et les forêts des populations pauvres pour les céder aux multinationales.
- Réduire la production manufacturière et alimentaire au détriment de l'exportation de ressources naturelles et de matières premières.
Les gouvernements du tiers monde ont historiquement été contraints d'accepter un ensemble de ces politiques - parfois connu sous le nom de "consensus de Washington" - afin de déclencher le déblocage continu des prêts de la Banque et du Fonds.
Les anciennes puissances coloniales ont tendance à concentrer leurs prêts de "développement" sur leurs anciennes colonies ou zones d'influence : La France en Afrique de l'Ouest, le Japon en Indonésie, la Grande-Bretagne en Afrique de l'Est et en Asie du Sud et les États-Unis en Amérique latine. Un exemple notable est la zone CFA, où 180 millions de personnes dans 15 pays africains sont encore obligées d'utiliser une monnaie coloniale française. À la suggestion du FMI, la France a dévalué le CFA de 50 % en 1994, dévastant l'épargne et le pouvoir d'achat de dizaines de millions de personnes vivant dans des pays allant du Sénégal à la Côte d'Ivoire en passant par le Gabon, tout cela pour rendre les exportations de matières premières plus compétitives.
Le résultat des politiques de la Banque et du Fonds sur le tiers-monde a été remarquablement similaire à ce qui a été vécu sous l'impérialisme traditionnel : déflation salariale, perte d'autonomie et dépendance agricole. La grande différence est que dans le nouveau système, l'épée et le fusil ont été remplacés par une dette militarisée.
Au cours des 30 dernières années, l'ajustement structurel s'est intensifié en ce qui concerne le nombre moyen de conditions dans les prêts accordés par la Banque et le Fonds. Avant 1980, la Banque ne faisait généralement pas de prêts d'ajustement structurel, la plupart des prêts étaient spécifiques à un projet ou à un secteur. Mais depuis lors, les prêts de sauvetage "dépensez-les comme vous voulez" assortis de contreparties économiques sont devenus une part croissante de la politique de la Banque. Pour le FMI, ils sont l'élément vital de sa politique.
Par exemple, lorsque le FMI a renfloué la Corée du Sud et l'Indonésie avec des paquets de 57 et 43 milliards de dollars pendant la crise financière asiatique de 1997, il a imposé de lourdes conditions. Les emprunteurs ont dû signer des accords qui "ressemblaient plus à des arbres de Noël qu'à des contrats, avec entre 50 et 80 conditions détaillées couvrant tout, de la déréglementation des monopoles de l'ail aux taxes sur les aliments pour bétail et aux nouvelles lois environnementales", selon le politologue Mark S. Copelvitch.
Une analyse de 2014 a montré que le FMI avait attaché, en moyenne, 20 conditions à chaque prêt qu'il a accordé au cours des deux années précédentes, une augmentation historique. Des pays comme la Jamaïque, la Grèce et Chypre ont emprunté ces dernières années avec une moyenne de 35 conditions chacun. Il convient de noter que les conditions de la Banque et du Fonds n'ont jamais inclus de protection de la liberté d'expression ou des droits de l'homme, ni de restrictions des dépenses militaires ou des violences policières.
Un autre aspect de la politique de la Banque et du Fonds est ce que l'on appelle le "double prêt" : de l'argent est prêté pour construire, par exemple, un barrage hydroélectrique, mais la majeure partie, voire la totalité, de l'argent est versée à des entreprises occidentales. Ainsi, le contribuable du tiers monde doit payer le principal et les intérêts, et le Nord est doublement remboursé.
Le contexte de ce double prêt est le suivant : les États dominants accordent des crédits, par l'intermédiaire de la Banque et du Fonds, à d'anciennes colonies, où les dirigeants locaux dépensent souvent l'argent frais en le reversant directement aux multinationales qui profitent des services de conseil, de construction ou d'importation. La dévaluation de la monnaie, le contrôle des salaires et le resserrement du crédit bancaire qui s'ensuivent et qui sont imposés par l'ajustement structurel de la Banque et du Fonds désavantagent les entrepreneurs locaux qui sont coincés dans un système fiat isolé et qui s'effondre, et profitent aux multinationales qui sont natives du dollar, de l'euro ou du yen.
Une autre source essentielle pour cet auteur a été le livre magistral "The Lords of Poverty" de l'historien Graham Hancock, écrit pour réfléchir sur les cinq premières décennies de la politique de la Banque et du Fonds et de l'aide étrangère en général.
"La Banque mondiale, écrit Hancock, est la première à admettre que sur chaque dizaine de dollars qu'elle reçoit, environ 7 dollars sont en fait dépensés en biens et services provenant des riches pays industrialisés."
Dans les années 1980, alors que le financement de la Banque se développait rapidement dans le monde, il a noté que "pour chaque dollar d'impôt américain versé, 82 cents sont immédiatement retournés aux entreprises américaines sous forme de bons de commande." Cette dynamique s'applique non seulement aux prêts mais aussi à l'aide. Par exemple, lorsque les États-Unis ou l'Allemagne envoient un avion de sauvetage dans un pays en crise, le coût du transport, de la nourriture, des médicaments et des salaires du personnel s'ajoute à ce qu'on appelle l'APD, ou "aide publique au développement". Dans les livres, cela ressemble à de l'aide et de l'assistance. Mais la majeure partie de l'argent est reversée directement aux entreprises occidentales et n'est pas investie localement.
En réfléchissant à la crise de la dette du tiers monde des années 1980, M. Hancock a noté que "70 cents sur chaque dollar d'aide américaine n'ont jamais quitté les États-Unis". Le Royaume-Uni, quant à lui, a dépensé un énorme 80% de son aide pendant cette période directement sur des biens et services britanniques.
"Une année", écrit Hancock, "les contribuables britanniques ont fourni 495 millions de livres aux agences d'aide multilatérale ; la même année, cependant, les entreprises britanniques ont reçu des contrats d'une valeur de 616 millions de livres." Selon Hancock, on pouvait "compter sur les agences multilatérales pour acheter des biens et services britanniques d'une valeur équivalente à 120% de la contribution multilatérale totale de la Grande-Bretagne."
On commence à voir comment "l'aide et l'assistance" que nous avons tendance à considérer comme charitable est en réalité tout le contraire.
Et comme le souligne Hancock, les budgets d'aide à l'étranger augmentent toujours, quel que soit le résultat. De même que les progrès sont la preuve que l'aide fonctionne, "l'absence de progrès est la preuve que le dosage a été insuffisant et doit être augmenté".
Certains défenseurs du développement, écrit-il, "soutiennent qu'il serait inopportun de refuser l'aide aux rapides (ceux qui progressent) ; d'autres, qu'il serait cruel de la refuser aux nécessiteux (ceux qui stagnent). L'aide est donc comme le champagne : en cas de succès, on la mérite, en cas d'échec, on en a besoin."
IV. Le Piège De La Dette
"Le concept de tiers monde ou de Sud et la politique d'aide publique sont indissociables. Ils sont les deux faces d'une même pièce. Le tiers-monde est la création de l'aide étrangère : sans aide étrangère, il n'y a pas de tiers-monde."
- Péter Tamás Bauer
Selon la Banque mondiale, son objectif est "d'aider à élever le niveau de vie dans les pays en développement en canalisant les ressources financières des pays développés vers le monde en développement."
Mais que faire si la réalité est tout autre ?
Dans un premier temps, à partir des années 1960, il y a eu un énorme flux de ressources des pays riches vers les pays pauvres. Cela était ostensiblement fait pour les aider à se développer. Payer écrit qu'il a longtemps été considéré comme "naturel" que les capitaux "circulent dans un seul sens, des économies industrielles développées vers le tiers monde."
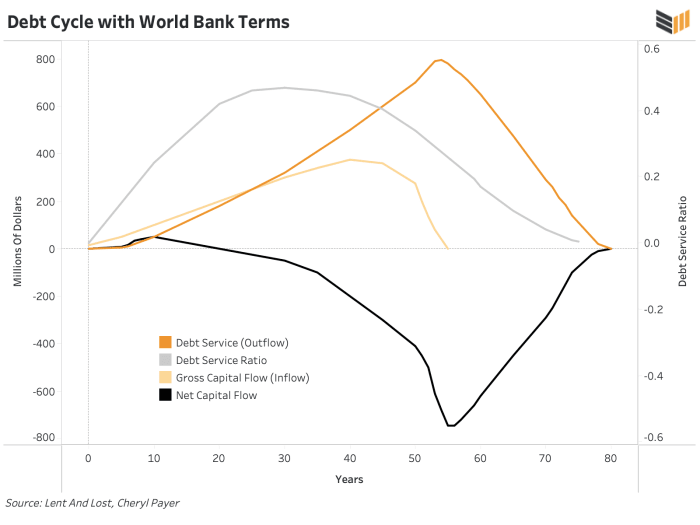
Mais, comme elle nous le rappelle, "à un moment donné, l'emprunteur doit payer plus à son créancier que ce qu'il a reçu de lui et, sur la durée du prêt, cet excédent est beaucoup plus élevé que le montant initialement emprunté."
En économie mondiale, ce point s'est produit en 1982, lorsque le flux des ressources s'est définitivement inversé. Depuis lors, il y a un flux annuel net de fonds des pays pauvres vers les pays riches. Ce flux, qui s'élevait en moyenne à 30 milliards de dollars par an du Sud vers le Nord au milieu et à la fin des années 1980, s'élève aujourd'hui à plusieurs milliers de milliards de dollars par an. Entre 1970 et 2007 - de la fin de l'étalon-or à la grande crise financière - le service de la dette payé par les pays pauvres aux pays riches a atteint 7,15 trillions de dollars.
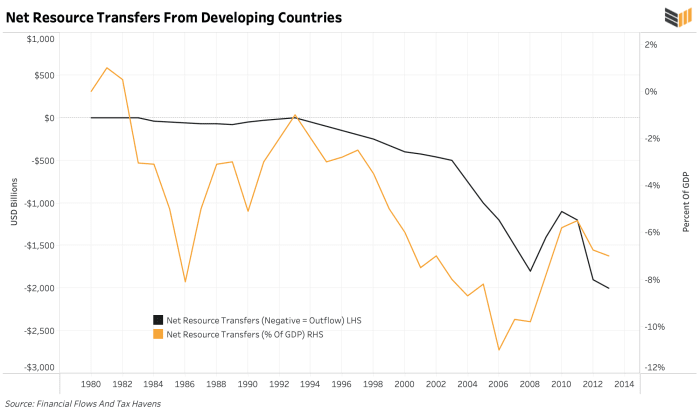
Pour donner un exemple de ce à quoi cela peut ressembler pour une année donnée, en 2012, les pays en développement ont reçu 1300 milliards de dollars, tous revenus, aides et investissements confondus. Mais cette même année, plus de 3 300 milliards de dollars sont sortis. En d'autres termes, selon l'anthropologue Jason Hickel, "les pays en développement ont envoyé 2 000 milliards de dollars de plus au reste du monde qu'ils n'en ont reçu."
Lorsque tous les flux ont été additionnés de 1960 à 2017, une sombre vérité est apparue : 62000 milliards de dollars ont été drainés hors du monde en développement, l'équivalent de 620 plans Marshall en dollars d'aujourd'hui.
Le FMI et la Banque mondiale étaient censés régler les problèmes de balance des paiements et aider les pays pauvres à devenir plus forts et plus durables. Or, c'est tout le contraire qui s'est produit.
"Pour chaque dollar d'aide que les pays en développement reçoivent", écrit Hickel, "ils perdent 24 dollars en sorties nettes de capitaux." Au lieu de mettre fin à l'exploitation et aux échanges inégaux, les études montrent que les politiques d'ajustement structurel les ont fait croître de façon massive.
Depuis 1970, la dette publique extérieure des pays en développement est passée de 46 milliards de dollars à 8,7 trillions de dollars. Au cours des 50 dernières années, des pays comme l'Inde, les Philippines ou le Congo doivent désormais à leurs anciens maîtres coloniaux 189 fois le montant qu'ils devaient en 1970. Rien que pour le paiement des intérêts, ils ont payé 4,2 trillions de dollars depuis 1980.
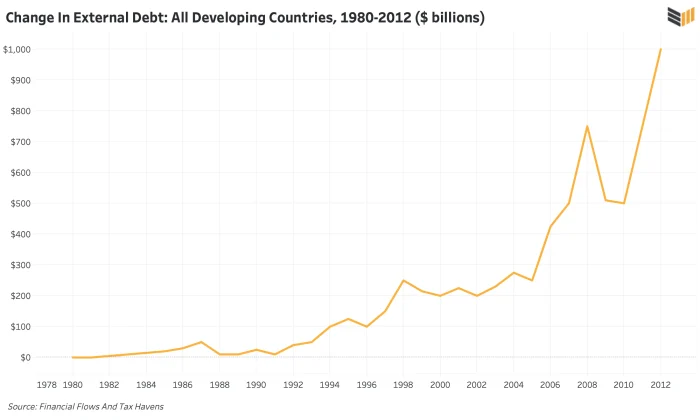
Même Payer - dont le livre de 1974 "The Debt Trap" utilisait des données sur les flux économiques pour montrer comment le FMI piégeait les pays pauvres en les encourageant à emprunter plus qu'ils ne pouvaient rembourser - serait choqué par l'ampleur du piège de la dette d'aujourd'hui.
Son observation selon laquelle "le citoyen moyen des États-Unis ou d'Europe n'est peut-être pas conscient de cette énorme fuite de capitaux de régions du monde qu'il considère comme pitoyablement pauvres" est toujours d'actualité. À sa propre honte, l'auteur ne connaissait pas la véritable nature du flux mondial de fonds et a simplement supposé que les pays riches subventionnaient les pays pauvres avant de se lancer dans les recherches pour ce projet. Le résultat final est un véritable système de Ponzi, dans lequel, dans les années 1970, la dette du tiers-monde était si importante qu'il n'était possible de la rembourser qu'avec de nouvelles dettes. Il en a été de même depuis lors.
De nombreux détracteurs de la Banque et du Fonds partent du principe que ces institutions travaillent avec le cœur au bon endroit, et que lorsqu'elles échouent, c'est à cause d'erreurs, de gaspillage ou de mauvaise gestion.
La thèse de cet essai est que ce n'est pas vrai, et que les objectifs fondamentaux du Fonds et de la Banque ne sont pas de résoudre le problème de la pauvreté, mais plutôt d'enrichir les nations créancières au détriment des nations pauvres.
L'auteur ne veut tout simplement pas croire qu'un flux permanent de fonds des pays pauvres vers les pays riches depuis 1982 est une "erreur". Le lecteur peut contester que cet arrangement soit intentionnel, et peut plutôt penser qu'il s'agit d'un résultat structurel inconscient. La différence importe peu pour les milliards de personnes que la Banque et le Fonds ont appauvries.
V. Remplacer La Fuite Des Ressources Coloniales
"Je suis tellement fatigué d'attendre. N'est-ce pas le cas pour vous, que le monde devienne bon, beau et gentil ? Prenons un couteau et coupons le monde en deux - et voyons quels vers mangent l'écorce."
- Langston Hughes
À la fin des années 1950, l'Europe et le Japon s'étaient largement remis de la guerre et avaient renoué avec une croissance industrielle significative, tandis que les pays du tiers monde manquaient de fonds. Malgré des bilans sains dans les années 1940 et au début des années 1950, les pays pauvres exportateurs de matières premières ont connu des problèmes de balance des paiements lorsque la valeur de leurs produits de base s'est effondrée à la suite de la guerre de Corée. C'est alors que le piège de la dette a commencé, et que la Banque et le Fonds ont ouvert les vannes de ce qui allait devenir des milliers de milliards de dollars de prêts.
Cette époque marque également la fin officielle du colonialisme, les empires européens se retirant de leurs possessions impériales. L'hypothèse de base du développement international est que la réussite économique des nations est due "principalement à leurs conditions internes". Les pays à revenu élevé ont connu le succès économique", selon la théorie, "grâce à une bonne gouvernance, des institutions fortes et des marchés libres. Les pays à faible revenu n'ont pas réussi à se développer parce qu'ils n'ont pas ces éléments, ou parce qu'ils souffrent de corruption, de bureaucratie et d'inefficacité."
C'est certainement vrai. Mais une autre raison majeure pour laquelle les pays riches sont riches et les pays pauvres sont pauvres est que les premiers ont pillé les seconds pendant des centaines d'années au cours de la période coloniale.
"La révolution industrielle britannique", écrit Jason Hickel, "dépendait en grande partie du coton, qui était cultivé sur des terres appropriées par la force aux Américains indigènes, avec une main-d'œuvre appropriée aux Africains réduits en esclavage. D'autres intrants essentiels dont les fabricants britanniques avaient besoin - chanvre, bois, fer, céréales - étaient produits par le travail forcé sur des domaines de serfs en Russie et en Europe de l'Est. Pendant ce temps, l'extraction britannique de l'Inde et d'autres colonies finançait plus de la moitié du budget intérieur du pays, payant les routes, les bâtiments publics, l'État-providence - tous les marchés du développement moderne - tout en permettant l'achat des intrants matériels nécessaires à l'industrialisation."
La dynamique du vol a été décrite par Utsa et Prabhat Patnaik dans leur livre "Capital And Imperialism" : les puissances coloniales comme l'empire britannique utilisaient la violence pour extraire les matières premières des pays faibles, créant ainsi une "fuite coloniale" de capitaux qui dopaient et subventionnaient la vie à Londres, Paris et Berlin. Les nations industrielles transformaient ces matières premières en produits manufacturés et les revendaient aux nations plus faibles, réalisant ainsi des bénéfices massifs tout en évinçant la production locale. Et - point crucial - elles maintiendraient l'inflation au niveau national en supprimant les salaires dans les territoires coloniaux. Soit par l'esclavage pur et simple, soit en payant bien en dessous du taux du marché mondial.
Lorsque le système colonial a commencé à vaciller, le monde financier occidental a été confronté à une crise. Les Patnaiks affirment que la Grande Dépression n'est pas seulement le résultat de changements dans la politique monétaire occidentale, mais aussi du ralentissement de la fuite des capitaux coloniaux. Le raisonnement est simple : les pays riches avaient construit un tapis roulant de ressources provenant des pays pauvres, et lorsque ce tapis s'est rompu, tout le reste s'est écroulé. Entre les années 1920 et 1960, le colonialisme politique a pratiquement disparu. La Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Japon, les Pays-Bas, la Belgique et d'autres empires ont été contraints d'abandonner le contrôle de plus de la moitié du territoire et des ressources du monde.
Comme l'écrivent les Patnaiks, l'impérialisme est "un arrangement pour imposer la déflation des revenus à la population du tiers-monde afin d'obtenir ses produits de base sans se heurter au problème de l'augmentation du prix de l'offre."
Après 1960, c'est devenu la nouvelle fonction de la Banque mondiale et du FMI : recréer la fuite coloniale des pays pauvres vers les pays riches qui était autrefois entretenue par l'impérialisme pur et dur.
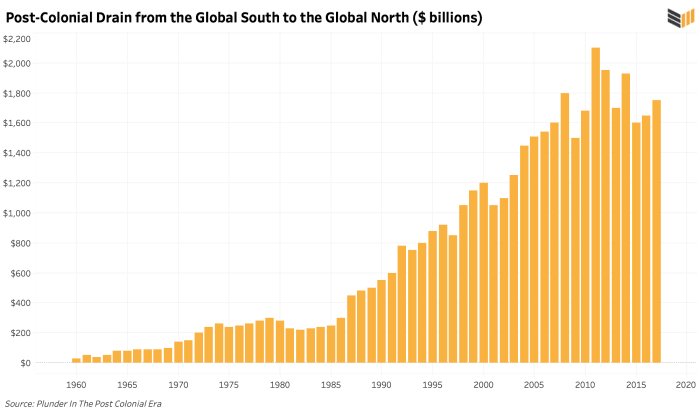
Les responsables américains, européens et japonais voulaient atteindre l'"équilibre interne", autrement dit le plein emploi. Mais ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas y parvenir par le biais de subventions à l'intérieur d'un système isolé, sous peine de voir l'inflation galoper. Pour atteindre leur objectif, il leur fallait un apport extérieur de la part des pays plus pauvres. La plus-value supplémentaire extraite par le noyau dur des travailleurs de la périphérie est connue sous le nom de "rente impérialiste". Si les pays industriels pouvaient obtenir des matériaux et une main-d'œuvre moins chers, puis revendre les produits finis avec un bénéfice, ils pourraient se rapprocher de l'économie de rêve des technocrates. Et leur souhait a été exaucé : en 2019, les salaires versés aux travailleurs du monde en développement représentaient 20% du niveau des salaires versés aux travailleurs du monde développé.
Pour illustrer la façon dont la Banque a recréé la dynamique de drainage coloniale, Payer donne le cas classique de la Mauritanie des années 1960, dans le nord-ouest de l'Afrique. Un projet minier appelé MIFERMA a été signé par les occupants français avant que la colonie ne devienne indépendante. L'accord a fini par devenir "un simple projet d'enclave à l'ancienne : une ville dans un désert et un chemin de fer menant à l'océan", car l'infrastructure était uniquement axée sur l'exportation de minéraux vers les marchés internationaux. En 1969, alors que la mine représentait 30% du PIB de la Mauritanie et 75% de ses exportations, 72% des revenus étaient envoyés à l'étranger, et "pratiquement tous les revenus distribués localement aux employés s'évaporaient dans les importations." Lorsque les mineurs ont protesté contre cet arrangement néocolonial, les forces de sécurité les ont sauvagement réprimés.
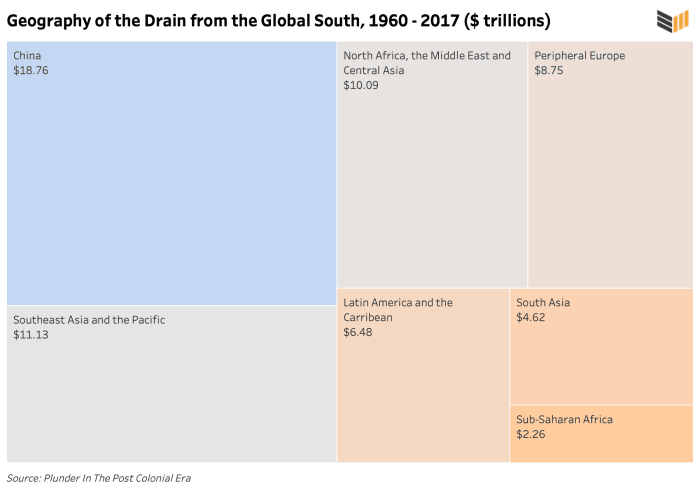
Le MIFERMA est un exemple stéréotypé du type de "développement" qui serait imposé au tiers monde partout, de la République dominicaine à Madagascar en passant par le Cambodge. Et tous ces projets se sont rapidement développés dans les années 1970, grâce au système des pétrodollars.
Après 1973, les pays arabes de l'OPEP, qui disposaient d'énormes excédents grâce à la montée en flèche des prix du pétrole, ont englouti leurs bénéfices dans des dépôts et des trésoreries dans les banques occidentales, qui avaient besoin d'un endroit où prêter leurs ressources croissantes. Les dictateurs militaires d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie faisaient d'excellentes cibles : ils avaient des préférences temporelles élevées et étaient heureux d'emprunter sur les générations futures.
Le "put FMI" a contribué à accélérer la croissance des prêts : les banques privées ont commencé à croire (à juste titre) que le FMI renflouerait les pays en cas de défaillance, protégeant ainsi leurs investissements. De plus, au milieu des années 1970, les taux d'intérêt étaient souvent en territoire réel négatif, ce qui encourageait encore plus les emprunteurs. Cette situation, combinée à l'insistance du président de la Banque mondiale, Robert McNamara, pour que l'aide augmente de façon spectaculaire, a entraîné une frénésie d'endettement. Les banques américaines, par exemple, ont augmenté leur portefeuille de prêts au tiers monde de 300% pour atteindre 450 milliards de dollars entre 1978 et 1982.
Le problème est que ces prêts étaient en grande partie des accords de taux d'intérêt flottants, et quelques années plus tard, ces taux ont explosé lorsque la Réserve fédérale américaine a augmenté le coût global du capital de près de 20 %. Le fardeau croissant de la dette, combiné au choc pétrolier de 1979 et à l'effondrement mondial du prix des matières premières qui alimentent la valeur des exportations des pays en développement, a ouvert la voie à la crise de la dette du tiers monde. Pour ne rien arranger, une très faible partie de l'argent emprunté par les gouvernements pendant la frénésie de la dette a été investie dans le citoyen moyen.
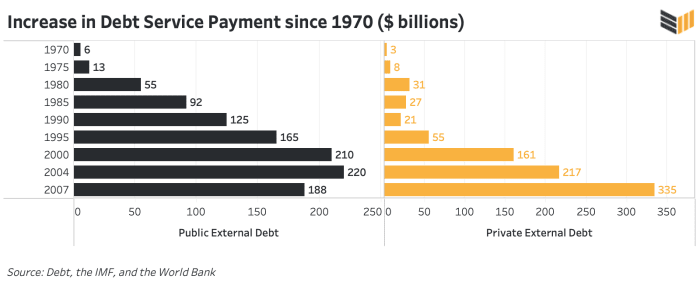
Dans leur livre bien nommé "Debt Squades", les journalistes d'investigation Sue Branford et Bernardo Kucinski expliquent qu'entre 1976 et 1981, les gouvernements latins (dont 18 sur 21 étaient des dictatures) ont emprunté 272,9 milliards de dollars. Sur ce montant, 91,6 % ont été consacrés au service de la dette, à la fuite des capitaux et à la constitution de réserves du régime. Seuls 8,4 % ont été utilisés pour des investissements nationaux, et même sur ce montant, une grande partie a été gaspillée.
Carlos Ayuda, défenseur de la société civile brésilienne, a décrit de manière saisissante l'effet de la fuite des capitaux alimentée par les pétrodollars sur son propre pays :
"La dictature militaire a utilisé les prêts pour investir dans d'énormes projets d'infrastructure - en particulier des projets énergétiques... l'idée derrière la création d'un énorme barrage et d'une usine hydroélectrique au milieu de l'Amazonie, par exemple, était de produire de l'aluminium pour l'exporter vers le Nord... le gouvernement a contracté d'énormes prêts et investi des milliards de dollars dans la construction du barrage de Tucuruí à la fin des années 1970, détruisant les forêts indigènes et déplaçant un nombre massif d'indigènes et de ruraux pauvres qui vivaient là depuis des générations. Le gouvernement aurait bien rasé les forêts, mais les délais étaient si courts qu'il a utilisé l'agent orange pour défolier la région, puis a immergé sous l'eau les troncs d'arbres sans feuilles... l'énergie de la centrale hydroélectrique [était alors] vendue entre 13 et 20 dollars par mégawatt alors que le prix réel de production était de 48 dollars. Les contribuables ont donc fourni des subventions, finançant une énergie bon marché pour que les sociétés transnationales puissent vendre notre aluminium sur le marché international."
En d'autres termes, le peuple brésilien a payé des créanciers étrangers pour le service de destruction de son environnement, de déplacement des masses et de vente de ses ressources.
Aujourd'hui, la fuite des pays à revenu faible ou intermédiaire est stupéfiante. En 2015, elle s'élevait à 10,1 milliards de tonnes de matières premières et 182 millions d'années-personnes de travail : 50 % de tous les biens et 28 % de toute la main-d'œuvre utilisée cette année-là par les pays à revenu élevé.
VI. Une Danse Avec Les Dictateurs
"C'est peut-être un fils de pute, mais c'est notre fils de pute."
- Franklin Delano Roosevelt
Bien sûr, il faut deux parties pour finaliser un prêt de la Banque ou du Fonds. Le problème est que l'emprunteur est généralement un dirigeant non élu ou non responsable, qui prend la décision sans consulter et sans mandat populaire de ses citoyens.
Comme l'écrit Payer dans "The Debt Trap", "les programmes du FMI sont politiquement impopulaires, pour les très bonnes raisons concrètes qu'ils nuisent aux entreprises locales et dépriment le revenu réel de l'électorat. Un gouvernement qui tente d'appliquer les conditions de la lettre d'intention qu'il a adressée au FMI a toutes les chances d'être démis de ses fonctions par les électeurs."
Le FMI préfère donc travailler avec des clients non démocratiques qui peuvent plus facilement révoquer des juges gênants et réprimer les manifestations de rue. Selon M. Payer, les coups d'État militaires au Brésil en 1964, en Turquie en 1960, en Indonésie en 1966, en Argentine en 1966 et aux Philippines en 1972 sont des exemples de dirigeants opposés au FMI qui ont été remplacés par la force par des dirigeants favorables au FMI. Même si le Fonds n'a pas été directement impliqué dans le coup d'État, dans chacun de ces cas, il est arrivé avec enthousiasme quelques jours, semaines ou mois plus tard pour aider le nouveau régime à mettre en œuvre l'ajustement structurel.
La Banque et le Fonds partagent la même volonté de soutenir les gouvernements abusifs. Il est peut-être surprenant de constater que c'est la Banque qui a lancé cette tradition. Selon le chercheur en développement Kevin Danaher, "le triste bilan de la Banque en matière de soutien aux régimes militaires et aux gouvernements qui violaient ouvertement les droits de l'homme a commencé le 7 août 1947, avec un prêt de 195 millions de dollars pour la reconstruction des Pays-Bas. Dix-sept jours avant que la Banque n'approuve ce prêt, les Pays-Bas avaient déclenché une guerre contre les nationalistes anticolonialistes dans leur immense empire d'outre-mer des Indes orientales, qui avait déjà déclaré son indépendance sous le nom de République d'Indonésie."
"Les Néerlandais, écrit Danaher, ont envoyé 145 000 soldats (d'une nation qui ne comptait que 10 millions d'habitants à l'époque et qui luttait économiquement à 90 % de la production de 1939) et ont lancé un blocus économique total des zones tenues par les nationalistes, provoquant une faim considérable et des problèmes sanitaires parmi les 70 millions d'habitants de l'Indonésie."
Au cours de ses premières décennies, la Banque a financé de nombreux projets coloniaux de ce type, dont 28 millions de dollars pour la Rhodésie de l'apartheid en 1952, ainsi que des prêts à l'Australie, au Royaume-Uni et à la Belgique pour "développer" des possessions coloniales en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Kenya et au Congo belge.
En 1966, la Banque a directement défié les Nations unies, "continuant à prêter de l'argent à l'Afrique du Sud et au Portugal malgré les résolutions de l'Assemblée générale demandant à toutes les agences affiliées à l'ONU de cesser leur soutien financier aux deux pays", selon Danaher.
Danaher écrit que "la domination coloniale de l'Angola et du Mozambique par le Portugal et l'apartheid de l'Afrique du Sud étaient des violations flagrantes de la charte de l'ONU. Mais la Banque a fait valoir que l'article IV, section 10 de sa charte, qui interdit l'ingérence dans les affaires politiques de tout membre, l'obligeait légalement à ignorer les résolutions de l'ONU. En conséquence, la Banque a approuvé des prêts de 10 millions de dollars au Portugal et de 20 millions de dollars à l'Afrique du Sud après l'adoption de la résolution des Nations unies."
Parfois, la préférence de la Banque pour la tyrannie était flagrante : elle a cessé de prêter au gouvernement Allende, démocratiquement élu au Chili, au début des années 1970, mais peu après, elle a commencé à prêter d'énormes quantités d'argent à la Roumanie de Ceausescu, l'un des pires États policiers du monde. C'est également un exemple qui montre que la Banque et le Fonds, contrairement à ce que l'on croit généralement, ne se contentaient pas de prêter selon les lignes idéologiques de la guerre froide : pour chaque client de droite d'Augusto Pinochet Ugarte ou de Jorge Rafael Videla, il y avait un Josip Broz Tito ou un Julius Nyerere de gauche.
En 1979, note Danaher, 15 des gouvernements les plus répressifs du monde recevront un bon tiers de tous les prêts de la Banque. Et ce, même après que le Congrès américain et l'administration Carter aient mis fin à l'aide accordée à quatre de ces 15 pays - l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et l'Éthiopie - pour "violations flagrantes des droits de l'homme". Quelques années plus tard, au Salvador, le FMI a accordé un prêt de 43 millions de dollars à la dictature militaire, quelques mois seulement après que ses forces aient commis le plus grand massacre de l'Amérique latine de l'époque de la guerre froide en anéantissant le village d'El Mozote.
Plusieurs livres ont été écrits sur la Banque et le Fonds en 1994, à l'occasion des rétrospectives des 50 ans des institutions de Bretton Woods. "Perpetuating Poverty" de Ian Vàsquez et Doug Bandow est l'une de ces études, particulièrement précieuse car elle propose une analyse libertaire. La plupart des études critiques de la Banque et du Fonds proviennent de la gauche : mais Vásquez et Bandow, du Cato Institute, ont constaté bon nombre des mêmes problèmes.
"La Chine devait 600 millions de dollars au Fonds à la fin de 1989 ; en janvier 1990, quelques mois seulement après que le sang eut séché sur la place Tiananmen à Pékin, le FMI a organisé un séminaire sur la politique monétaire dans la ville."
Vásquez et Bandow mentionnent d'autres clients tyranniques, de la Birmanie militaire au Chili de Pinochet, en passant par le Laos, le Nicaragua d'Anastasio Somoza Debayle et des Sandinistes, la Syrie et le Vietnam.
"Le FMI, disent-ils, a rarement rencontré une dictature qu'il n'aimait pas".
Vásquez et Bandow détaillent la relation de la Banque avec le régime marxiste-léniniste de Mengistu Haile Mariam en Éthiopie, où elle a fourni jusqu'à 16 % du budget annuel du gouvernement alors que celui-ci affichait l'un des pires bilans au monde en matière de droits de l'homme. Le crédit de la Banque est arrivé au moment où les forces de Mengistu "rassemblaient les gens dans des camps de concentration et des fermes collectives". Ils soulignent également comment la Banque a donné 16 millions de dollars au régime soudanais alors qu'il chassait 750 000 réfugiés de Khartoum dans le désert, et comment elle a donné des centaines de millions de dollars à l'Iran - une dictature théocratique brutale - et au Mozambique, dont les forces de sécurité étaient tristement célèbres pour leurs tortures, leurs viols et leurs exécutions sommaires.
Dans son livre de 2011 intitulé "Defeating Dictators", le célèbre économiste du développement ghanéen George Ayittey a détaillé une longue liste d'"autocrates bénéficiaires d'aide" : Paul Biya, Idriss Déby, Lansana Conté, Paul Kagame, Yoweri Museveni, Hun Sen, Islam Karimov, Nursultan Nazarbayev et Emomali Rahmon. Il a souligné que le Fonds avait dispensé 75 milliards de dollars à ces neuf tyrans seulement.
En 2014, un rapport a été publié par le Consortium international des journalistes d'investigation, alléguant que le gouvernement éthiopien avait utilisé une partie d'un prêt de 2 milliards de dollars de la Banque pour déplacer de force 37 883 familles autochtones Anuak. Cela représentait 60 % de la totalité de la province de Gambella du pays. Les soldats ont "battu, violé et tué" les Anuak qui refusaient de quitter leur maison. Les atrocités étaient si graves que le Sud-Soudan a accordé le statut de réfugié aux Anuaks qui affluaient de l'Éthiopie voisine. Un rapport de Human Rights Watch indique que les terres volées ont ensuite été "louées par le gouvernement à des investisseurs" et que l'argent de la Banque a été "utilisé pour payer les salaires des fonctionnaires du gouvernement qui ont aidé à réaliser les expulsions." La Banque a approuvé de nouveaux financements pour ce programme de "villagisation", même après que des allégations de violations massives des droits de l'homme aient émergé.

Ce serait une erreur d'omettre le Zaïre de Mobutu Sese Soko dans cet essai. Bénéficiaire de milliards de dollars de crédits de la Banque et du Fonds pendant son règne sanglant de 32 ans, Mobutu a empoché 30% de l'aide et de l'assistance reçues et a laissé son peuple mourir de faim. Il s'est plié à 11 ajustements structurels du FMI : lors de l'un d'entre eux, en 1984, 46 000 enseignants de l'enseignement public ont été licenciés et la monnaie nationale a été dévaluée de 80 %. Mobutu a qualifié cette austérité de "pilule amère que nous n'avons d'autre choix que d'avaler", mais n'a vendu aucune de ses 51 Mercedes, aucun de ses 11 châteaux en Belgique ou en France, ni même son Boeing 747 ou son château espagnol du XVIe siècle.
Le revenu par habitant a diminué en moyenne de 2,2% chaque année de son règne, laissant plus de 80 % de la population dans une pauvreté absolue. Les enfants mouraient couramment avant l'âge de cinq ans et le syndrome du ventre gonflé était endémique. On estime que Mobutu a personnellement volé 5 milliards de dollars et qu'il a présidé à la fuite de 12 milliards de dollars de capitaux, ce qui aurait été plus que suffisant pour effacer la dette de 14 milliards de dollars du pays au moment de son éviction. Il a pillé et terrorisé son peuple, et n'aurait pas pu le faire sans la Banque et le Fonds, qui ont continué à le renflouer alors qu'il était évident qu'il ne rembourserait jamais ses dettes.
Cela dit, le véritable exemple de l'affection de la Banque et du Fonds pour les dictateurs est peut-être Ferdinand Marcos. En 1966, lorsque Marcos est arrivé au pouvoir, les Philippines étaient le deuxième pays le plus prospère d'Asie, et la dette extérieure du pays s'élevait à environ 500 millions de dollars. Lorsque Marcos a été destitué en 1986, la dette s'élevait à 28,1 milliards de dollars.
Comme l'écrit Graham Hancock dans "Lords Of Poverty", la plupart de ces prêts "ont été contractés pour financer des programmes de développement extravagants qui, bien que sans intérêt pour les pauvres, ont flatté l'énorme ego du chef de l'État... une enquête minutieuse de deux ans a établi sans contestation possible qu'il avait personnellement exproprié et envoyé hors des Philippines plus de 10 milliards de dollars. Une grande partie de cet argent - qui, bien sûr, aurait dû être à la disposition de l'État et du peuple philippins - avait disparu à jamais dans des comptes bancaires suisses."
"100 millions de dollars, écrit Hancock, ont été versés pour la collection d'art d'Imelda Marcos... ses goûts étaient éclectiques et comprenaient six maîtres anciens achetés à la galerie Knodeler de New York pour 5 millions de dollars, une toile de Francis Bacon fournie par la galerie Marlborough de Londres, et un Michel-Ange, 'Madone et enfant' acheté à Mario Bellini à Florence pour 3,5 millions de dollars."
"Au cours de la dernière décennie du régime Marcos, dit-il, alors que de précieux trésors artistiques étaient accrochés aux murs des penthouse de Manhattan et de Paris, les Philippines avaient des normes nutritionnelles inférieures à celles de toute autre nation d'Asie, à l'exception du Cambodge déchiré par la guerre."
Pour contenir l'agitation populaire, Hancock écrit que Marcos a interdit les grèves et que "l'organisation syndicale était proscrite dans toutes les industries clés et dans l'agriculture. Des milliers de Philippins ont été emprisonnés pour s'être opposés à la dictature et beaucoup ont été torturés et tués. Pendant ce temps, le pays restait constamment classé parmi les principaux bénéficiaires de l'aide au développement des États-Unis et de la Banque mondiale."
Après avoir chassé Marcos, le peuple philippin devait encore payer une somme annuelle comprise entre 40 et 50 % de la valeur totale de ses exportations "juste pour couvrir les intérêts des dettes étrangères contractées par Marcos".
On pourrait penser qu'après avoir évincé Marcos, le peuple philippin n'aurait plus à payer la dette qu'il a contractée en son nom sans le consulter. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées dans la pratique. En théorie, ce concept est appelé "dette odieuse" et a été inventé par les États-Unis en 1898 lorsqu'ils ont répudié la dette de Cuba après l'éviction des forces espagnoles de l'île.
Les dirigeants américains ont déterminé que les dettes "contractées pour subjuguer un peuple ou le coloniser" n'étaient pas légitimes. Mais la Banque et le Fonds n'ont jamais suivi ce précédent au cours de leurs 75 années d'activité. Ironiquement, le FMI a publié sur son site web un article suggérant que Somoza, Marcos, l'Afrique du Sud de l'apartheid, le "Baby Doc" d'Haïti et le Sani Abacha du Nigeria ont tous emprunté des milliards de manière illégitime, et que la dette devrait être effacée pour leurs victimes, mais cette suggestion reste sans suite.
Techniquement et moralement parlant, un grand pourcentage de la dette du tiers-monde devrait être considéré comme "odieux" et ne plus être dû par la population si leur dictateur était chassé. Après tout, dans la plupart des cas, les citoyens qui remboursent les emprunts n'ont pas élu leur dirigeant et n'ont pas choisi d'emprunter les crédits qu'ils ont contractés contre leur avenir.
En juillet 1987, le leader révolutionnaire Thomas Sankara a prononcé un discours devant l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en Éthiopie, dans lequel il a refusé de payer la dette coloniale du Burkina Faso et a encouragé les autres nations africaines à le rejoindre.
Nous ne pouvons pas payer, a-t-il dit, car nous ne sommes pas responsables de cette dette."
Sankara est célèbre pour avoir boycotté le FMI et refusé l'ajustement structurel. Trois mois après son discours à l'OUA, il a été assassiné par Blaise Compaoré, qui allait mettre en place son propre régime militaire de 27 ans, qui recevrait quatre prêts d'ajustement structurel du FMI et emprunterait des dizaines de fois à la Banque mondiale pour divers projets d'infrastructure et d'agriculture. Depuis la mort de Sankara, peu de chefs d'État ont été disposés à prendre position pour répudier leurs dettes.

L'Irak constitue une exception de taille : après l'invasion américaine et l'éviction de Saddam Hussein en 2003, les autorités américaines ont réussi à faire considérer comme "odieuse" et à faire annuler une partie de la dette contractée par Hussein. Mais il s'agissait d'un cas unique : les milliards de personnes qui ont souffert sous les colonisateurs ou les dictateurs, et qui ont depuis été contraintes de payer leurs dettes plus les intérêts, n'ont pas bénéficié de ce traitement spécial.
Ces dernières années, le FMI a même agi comme une force contre-révolutionnaire contre les mouvements démocratiques. Dans les années 1990, le Fonds a été largement critiqué à gauche et à droite pour avoir contribué à déstabiliser l'ancienne Union soviétique, qui a sombré dans le chaos économique et s'est transformée en dictature de Vladimir Poutine. En 2011, alors que les manifestations du printemps arabe émergeaient à travers le Moyen-Orient, le partenariat de Deauville avec les pays arabes en transition a été formé et s'est réuni à Paris.
Grâce à ce mécanisme, la Banque et le Fonds ont mené des offres de prêts massifs au Yémen, à la Tunisie, à l'Égypte, au Maroc et à la Jordanie - des "pays arabes en transition" - en échange d'un ajustement structurel. En conséquence, la dette extérieure de la Tunisie est montée en flèche, déclenchant deux nouveaux prêts du FMI, marquant la première fois que le pays empruntait au Fonds depuis 1988. Les mesures d'austérité associées à ces prêts ont entraîné la dévaluation du dinar tunisien, ce qui a provoqué une flambée des prix. Des manifestations nationales ont éclaté alors que le gouvernement continuait à suivre le plan du Fonds en gelant les salaires, en créant de nouvelles taxes et en mettant à la retraite anticipée le secteur public.
Warda Atig, manifestante de vingt-neuf ans, a résumé la situation : "Tant que la Tunisie poursuivra ces accords avec le FMI, nous continuerons notre lutte", a-t-elle déclaré. "Nous pensons que le FMI et les intérêts du peuple sont contradictoires. Sortir de la soumission au FMI, qui a mis la Tunisie à genoux et étranglé l'économie, est une condition préalable à tout changement réel."
VII. Créer Une Dépendance Agricole
"L'idée que les pays en développement doivent se nourrir eux-mêmes est un anachronisme d'une époque révolue. Ils pourraient mieux assurer leur sécurité alimentaire en s'appuyant sur les produits agricoles américains, qui sont disponibles dans la plupart des cas à moindre coût."
- Ancien secrétaire américain à l'agriculture, John Block
Grâce à la politique de la Banque et du Fonds, dans toute l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud et de l'Est, des pays qui cultivaient autrefois leur propre nourriture l'importent désormais des pays riches. Il est important de cultiver sa propre nourriture, rétrospectivement, car dans le système financier de l'après-1944, les produits de base ne sont pas évalués avec la monnaie fiduciaire locale : ils sont évalués en dollars.
Prenons l'exemple du prix du blé, qui a oscillé entre 200 et 300 dollars entre 1996 et 2006. Depuis, il est monté en flèche, atteignant près de 1 100 dollars en 2021. Si votre pays cultivait son propre blé, il pourrait résister à la tempête. Si votre pays devait importer du blé, votre population risquait de mourir de faim. C'est l'une des raisons pour lesquelles des pays comme le Pakistan, le Sri Lanka, l'Égypte, le Ghana et le Bangladesh se tournent actuellement vers le FMI pour obtenir des prêts d'urgence.
Historiquement, lorsque la Banque accordait des prêts, ils étaient principalement destinés à l'agriculture "moderne", à grande échelle, à la monoculture et à l'extraction des ressources, et non au développement de l'industrie locale, de la fabrication ou de l'agriculture de consommation. Les emprunteurs étaient encouragés à se concentrer sur les exportations de matières premières (pétrole, minéraux, café, cacao, huile de palme, thé, caoutchouc, coton, etc.), puis poussés à importer des produits finis, des denrées alimentaires et les ingrédients de l'agriculture moderne tels que les engrais, les pesticides, les tracteurs et les machines d'irrigation. ), puis poussés à importer des produits finis, des denrées alimentaires et les ingrédients de l'agriculture moderne tels que les engrais, les pesticides, les tracteurs et les machines d'irrigation. Le résultat est que des sociétés comme le Maroc finissent par importer du blé et de l'huile de soja au lieu de prospérer grâce au couscous et à l'huile d'olive indigènes, "fixés" pour devenir dépendants. Les revenus ne sont généralement pas utilisés au profit des agriculteurs, mais pour assurer le service de la dette extérieure, acheter des armes, importer des produits de luxe, remplir des comptes bancaires suisses et réprimer la dissidence.
Prenons l'exemple de certains des pays les plus pauvres du monde. En 2020, après 50 ans de politique de la Banque et du Fonds, les exportations du Niger représentaient 75% de l'uranium, celles du Mali 72% de l'or, celles de la Zambie 70% du cuivre, celles du Burundi 69% du café, celles du Malawi 55% du tabac, celles du Togo 50% du coton, et ainsi de suite. Au cours des décennies passées, ces exportations uniques ont permis à ces pays de générer pratiquement tous leurs revenus en devises fortes. Il ne s'agit pas d'une situation naturelle. Ces articles ne sont pas extraits ou produits pour la consommation locale, mais pour les centrales nucléaires françaises, l'électronique chinoise, les supermarchés allemands, les fabricants de cigarettes britanniques et les entreprises de vêtements américaines. En d'autres termes, l'énergie de la main-d'œuvre de ces nations a été conçue pour nourrir et alimenter d'autres civilisations, au lieu de nourrir et de faire progresser la leur.
La chercheuse Alicia Koren a écrit sur l'impact agricole typique de la politique de la Banque au Costa Rica, où "l'ajustement structurel du pays exigeait de gagner davantage de devises fortes pour rembourser la dette extérieure ; il forçait les agriculteurs qui cultivaient traditionnellement des haricots, du riz et du maïs pour la consommation intérieure à planter des produits agricoles d'exportation non traditionnels tels que des plantes ornementales, des fleurs, des melons, des fraises et des poivrons rouges... Les industries qui exportaient leurs produits étaient admissibles à des exemptions tarifaires et fiscales dont ne bénéficiaient pas les producteurs nationaux".
"Pendant ce temps", écrit Koren, "les accords d'ajustement structurel ont supprimé le soutien à la production nationale... tandis que le Nord faisait pression sur les nations du Sud pour qu'elles éliminent les subventions et les "obstacles au commerce", les gouvernements du Nord ont injecté des milliards de dollars dans leurs propres secteurs agricoles, rendant impossible pour les producteurs de céréales de base du Sud de concurrencer l'industrie agricole hautement subventionnée du Nord."
Koren a extrapolé son analyse du Costa Rica pour faire un constat plus large : "Les accords d'ajustement structurel déplacent les subventions des dépenses publiques des produits de base, consommés principalement par les pauvres et les classes moyennes, vers les cultures d'exportation de luxe produites pour les étrangers fortunés." Les pays du tiers monde n'étaient pas considérés comme des corps politiques mais comme des entreprises qui devaient augmenter leurs revenus et diminuer leurs dépenses.
Le témoignage d'un ancien fonctionnaire jamaïcain est particulièrement révélateur : "Nous avons dit à l'équipe de la Banque mondiale que les agriculteurs pouvaient difficilement se permettre d'accorder des crédits, et que des taux plus élevés les mettraient en faillite. La Banque nous a répondu que cela signifiait que 'le marché vous dit que l'agriculture n'est pas la voie à suivre pour la Jamaïque' - ils disent que nous devrions abandonner complètement l'agriculture."
"La Banque mondiale et le FMI, poursuit le fonctionnaire, n'ont pas à s'inquiéter de la disparition des agriculteurs et des entreprises locales, ni des salaires de famine ou des bouleversements sociaux qui en résulteront. Ils partent simplement du principe que c'est à nous de maintenir nos forces de sécurité nationales suffisamment fortes pour réprimer tout soulèvement."
Les gouvernements des pays en développement sont coincés : face à une dette insurmontable, le seul facteur qu'ils contrôlent réellement en termes d'augmentation des revenus est la déflation des salaires. S'ils font cela, ils doivent fournir des subventions alimentaires de base, sinon ils seront renversés. Et ainsi, la dette augmente.
Même lorsque les pays en développement essaient de produire leur propre nourriture, ils sont évincés par un marché commercial mondial planifié de manière centralisée. Par exemple, on pourrait penser que la main-d'œuvre bon marché d'un endroit comme l'Afrique de l'Ouest en ferait un meilleur exportateur de cacahuètes que les États-Unis. Mais comme les pays du Nord versent chaque jour environ 1 milliard de dollars de subventions à leurs industries agricoles, les pays du Sud ont souvent du mal à être compétitifs. Pire encore, 50 ou 60 pays sont souvent invités à se concentrer sur les mêmes cultures, ce qui les évince les uns des autres sur le marché mondial. L'hévéa, l'huile de palme, le café, le thé et le coton sont les favoris des banques, car les masses pauvres ne peuvent pas les manger.
Il est vrai que la révolution verte a permis de produire davantage de nourriture pour la planète, notamment en Chine et en Asie de l'Est. Mais malgré les progrès de la technologie agricole, une grande partie de ces nouveaux rendements va à l'exportation, et de vastes pans du monde restent chroniquement mal nourris et dépendants. À ce jour, par exemple, les nations africaines importent environ 85% de leur nourriture. Ils paient plus de 40 milliards de dollars par an - un chiffre qui devrait atteindre 110 milliards de dollars par an d'ici 2025 - pour acheter dans d'autres régions du monde ce qu'ils pourraient cultiver eux-mêmes. La politique de la Banque et du Fonds a contribué à transformer un continent aux richesses agricoles incroyables en un continent dépendant du monde extérieur pour nourrir sa population.
Réfléchissant aux résultats de cette politique de dépendance, Hancock remet en question l'idée répandue selon laquelle les populations du tiers-monde sont "fondamentalement impuissantes".
"Les victimes de crises, de désastres et de catastrophes sans nom", écrit-il, souffrent de la perception qu'"elles ne peuvent rien faire à moins que nous, les riches et les puissants, n'intervenions pour les sauver d'elles-mêmes." Mais comme le prouve le fait que notre "assistance" n'a fait que les rendre plus dépendants de nous, Hancock démasque à juste titre la notion selon laquelle "nous seuls pouvons les sauver" comme étant "condescendante et profondément fallacieuse."
Loin de jouer le rôle de bon samaritain, le Fonds ne suit même pas la tradition humaine intemporelle, établie il y a plus de 4 000 ans par Hammurabi dans l'ancienne Babylone, de pardonner les intérêts après les catastrophes naturelles. En 1985, un tremblement de terre dévastateur a frappé Mexico City, tuant plus de 5 000 personnes et causant 5 milliards de dollars de dégâts. Le personnel du Fonds - qui prétend être un sauveur, aidant à mettre fin à la pauvreté et à sauver les pays en crise - est arrivé quelques jours plus tard, exigeant d'être remboursé.
VIII. Vous Ne Pouvez Pas Manger Le Coton
"Le développement préfère les cultures qui ne peuvent pas être mangées pour que les prêts puissent être collectés."
- Cheryl Payer
L'expérience personnelle et familiale de la Togolaise Farida Nabourema, défenseur de la démocratie, correspond tragiquement au tableau d'ensemble de la Banque et du Fonds exposé jusqu'ici.
Elle raconte qu'après le boom pétrolier des années 1970, des prêts ont été accordés à des pays en développement comme le Togo, dont les dirigeants, qui n'avaient aucun compte à rendre, n'ont pas réfléchi à la manière dont ils allaient rembourser la dette. Une grande partie de l'argent est allée à des projets d'infrastructure géants qui n'ont pas aidé la majorité de la population. Une grande partie a été détournée et dépensée dans des propriétés pharaoniques. La plupart de ces pays, dit-elle, étaient dirigés par des États à parti unique ou des familles. Lorsque les taux d'intérêt ont commencé à grimper, ces gouvernements ne pouvaient plus payer leurs dettes : le FMI a commencé à "prendre le relais" en imposant des mesures d'austérité.
"Il s'agissait de nouveaux États très fragiles", explique Nabourema dans une interview pour cet article. "Ils devaient investir fortement dans les infrastructures sociales, tout comme les États européens ont été autorisés à le faire après la Seconde Guerre mondiale. Mais au lieu de cela, nous sommes passés de la gratuité des soins de santé et de l'éducation un jour, à des situations le lendemain où il est devenu trop coûteux pour la personne moyenne d'obtenir ne serait-ce que des médicaments de base."
Indépendamment de ce que l'on pense de la médecine et de la scolarité subventionnées par l'État, leur élimination du jour au lendemain a été traumatisante pour les pays pauvres. Les fonctionnaires de la Banque et du Fonds ont bien sûr leurs propres solutions de soins de santé privés pour leurs visites et leurs propres écoles privées pour leurs enfants lorsqu'ils doivent vivre "sur le terrain".
En raison des coupes forcées dans les dépenses publiques, dit Nabourema, les hôpitaux publics du Togo restent à ce jour en "complète décrépitude". Contrairement aux hôpitaux publics financés par les contribuables dans les capitales des anciennes puissances coloniales à Londres et à Paris, la situation est si mauvaise à Lomé, la capitale du Togo, que même l'eau doit être prescrite.
"Il y a aussi eu," dit Nabourema, "une privatisation inconsidérée de nos entreprises publiques." Elle a expliqué comment son père travaillait à l'agence togolaise de l'acier. Lors de la privatisation, l'entreprise a été vendue à des acteurs étrangers pour moins de la moitié de ce pour quoi l'État l'avait construite.
"C'était en fait une vente de garage", a-t-elle déclaré.
Nabourema affirme qu'un système de marché libre et des réformes libérales fonctionnent bien lorsque tous les participants sont sur un pied d'égalité. Mais ce n'est pas le cas au Togo, qui est obligé de jouer selon des règles différentes. Il a beau s'ouvrir, il ne peut pas changer les politiques strictes des États-Unis et de l'Europe, qui subventionnent agressivement leurs propres industries et leur agriculture. Nabourema mentionne comment un afflux subventionné de vêtements d'occasion bon marché en provenance d'Amérique, par exemple, a ruiné l'industrie textile locale du Togo.
"Ces vêtements venus de l'Ouest, dit-elle, ont mis des entrepreneurs en faillite et jonché nos plages."
L'aspect le plus horrible, dit-elle, est que les agriculteurs - qui représentaient 60 % de la population du Togo dans les années 1980 - ont vu leurs moyens de subsistance bouleversés. La dictature avait besoin de devises fortes pour payer ses dettes, et ne pouvait le faire qu'en vendant des exportations, elle a donc lancé une campagne massive de vente de cultures commerciales. Avec l'aide de la Banque mondiale, le régime a investi massivement dans le coton, à tel point que celui-ci domine désormais 50 % des exportations du pays, détruisant la sécurité alimentaire nationale.
Dans les années de formation de pays comme le Togo, la Banque était le "plus grand prêteur unique pour l'agriculture". Sa stratégie de lutte contre la pauvreté était la modernisation de l'agriculture : "des transferts massifs de capitaux, sous forme d'engrais, de pesticides, de matériel de terrassement et de consultants étrangers coûteux."
C'est le père de Nabourema qui lui a révélé comment les engrais et les tracteurs importés étaient détournés des agriculteurs cultivant des aliments de consommation au profit des agriculteurs cultivant des cultures de rente comme le coton, le café, le cacao et les noix de cajou. Si quelqu'un cultivait du maïs, du sorgho ou du millet - les aliments de base de la population - il n'y avait pas accès.
"Vous ne pouvez pas manger du coton", nous rappelle Nabourema.
Au fil du temps, l'élite politique de pays comme le Togo et le Bénin (où le dictateur était littéralement un magnat du coton) est devenue l'acheteur de toutes les cultures de rente de toutes les exploitations. Ils avaient le monopole des achats, explique Nabourema, et achetaient les cultures à des prix si bas que les paysans gagnaient à peine de l'argent. Tout ce système - appelé "sotoco" au Togo - était basé sur des financements fournis par la Banque mondiale.
Lorsque les agriculteurs protestaient, disait-elle, ils étaient battus ou leurs fermes étaient réduites en cendres. Ils auraient pu se contenter de cultiver des aliments normaux et nourrir leurs familles, comme ils l'avaient fait depuis des générations. Mais aujourd'hui, ils n'ont même plus les moyens d'acheter des terres : l'élite politique en acquiert à un rythme effréné, souvent par des moyens illégaux, ce qui fait grimper les prix.
À titre d'exemple, Nabourema explique comment le régime togolais peut saisir 2 000 acres de terre : contrairement à ce qui se passe dans une démocratie libérale (comme celle de la France, qui a construit sa civilisation sur le dos de pays comme le Togo), le système judiciaire appartient au gouvernement, il n'y a donc aucun moyen de riposter. Ainsi, les agriculteurs, qui étaient autrefois autonomes, sont maintenant obligés de travailler comme ouvriers sur les terres de quelqu'un d'autre pour fournir du coton à des pays riches très éloignés. L'ironie la plus tragique, selon Nabourema, est que le coton est cultivé en grande majorité dans le nord du Togo, dans la partie la plus pauvre du pays.
"Mais quand vous allez là-bas, dit-elle, vous voyez que cela n'a enrichi personne".
Les femmes font les frais de l'ajustement structurel. La misogynie de cette politique est "tout à fait claire en Afrique, où les femmes sont les principales agricultrices et fournisseuses de combustible, de bois et d'eau", écrit Danaher. Et pourtant, selon une récente rétrospective, "la Banque mondiale préfère leur reprocher d'avoir trop d'enfants plutôt que de réexaminer ses propres politiques."
Comme l'écrit Payer, pour beaucoup de pauvres dans le monde, ils sont pauvres "non pas parce qu'ils ont été laissés pour compte ou ignorés par le progrès de leur pays, mais parce qu'ils sont les victimes de la modernisation. La plupart ont été évincés des bonnes terres agricoles, ou carrément privés de terres, par les riches élites et l'agrobusiness local ou étranger. Leur dénuement ne les a pas "exclus" du processus de développement ; le processus de développement a été la cause de leur dénuement."
"Pourtant, la Banque, poursuit Payer, est toujours déterminée à transformer les pratiques agricoles des petits exploitants. Les déclarations de politique générale de la Banque indiquent clairement que le véritable objectif est l'intégration des terres paysannes dans le secteur commercial par la production d'un 'surplus commercialisable' de cultures de rente."
Payer a observé comment, dans les années 1970 et 1980, de nombreux petits comploteurs cultivaient encore l'essentiel de leurs besoins alimentaires et n'étaient pas "dépendants du marché pour la quasi-totalité de leur subsistance, comme l'étaient les gens "modernes"". Ces personnes, cependant, étaient la cible des politiques de la Banque, qui les transformaient en producteurs excédentaires, et "imposaient souvent cette transformation par des méthodes autoritaires."
Dans un témoignage devant le Congrès américain dans les années 1990, George Ayittey a fait remarquer que "si l'Afrique était capable de se nourrir elle-même, elle pourrait économiser près de 15 milliards de dollars qu'elle gaspille en importations alimentaires. Ce chiffre peut être comparé aux 17 milliards de dollars que l'Afrique a reçus en aide étrangère, toutes sources confondues, en 1997."
En d'autres termes, si l'Afrique cultivait sa propre nourriture, elle n'aurait pas besoin d'aide étrangère. Mais si cela se produisait, les pays pauvres n'achèteraient pas des milliards de dollars de nourriture par an aux pays riches, dont les économies se contracteraient en conséquence. L'Occident s'oppose donc fermement à tout changement.
IX. Le Plateau De Développement
Excusez-moi, mes amis, je dois prendre mon jet.
Je suis en route pour rejoindre le plateau de développement
Mes bagages sont faits, et j'ai fait tous mes vaccins.
J'ai des traveller's checks et des pilules pour les trots !
Le Development Set est brillant et noble.
Nos pensées sont profondes et notre vision globale
Bien que nous nous déplacions avec les meilleures classes
Nos pensées sont toujours avec les masses
Dans les hôtels Sheraton des nations éparpillées
Nous condamnons les multinationales
Il semble facile de protester contre l'injustice
Dans ces foyers bouillonnants de repos social.
Nous discutons de la malnutrition autour d'un steak
Et nous planifions des discussions sur la faim pendant les pauses café.
Qu'il s'agisse d'inondations en Asie ou de sécheresse en Afrique
Nous affrontons chaque problème la bouche ouverte.
C'est ainsi que commence "The Development Set", un poème de Ross Coggins datant de 1976 qui s'attaque au cœur de la nature paternaliste et irresponsable de la Banque et du Fonds.
La Banque mondiale verse des salaires élevés, non imposables, assortis d'avantages très généreux. Le personnel du FMI est encore mieux payé et, traditionnellement, il voyageait en première classe ou en classe affaires (selon la distance), jamais en classe économique. Ils séjournaient dans des hôtels cinq étoiles, et avaient même l'avantage de bénéficier d'un surclassement gratuit sur le supersonique Concorde. Leurs salaires, contrairement à ceux des personnes vivant sous ajustement structurel, n'étaient pas plafonnés et augmentaient toujours plus vite que le taux d'inflation.
Jusqu'au milieu des années 1990, les concierges qui nettoyaient le siège de la Banque mondiale à Washington - pour la plupart des immigrants qui avaient fui les pays que la Banque et le Fonds avaient "ajustés" - n'étaient même pas autorisés à se syndiquer. En revanche, le salaire non imposable de Christine Lagarde en tant que directrice du FMI était de 467940 dollars, plus une allocation supplémentaire de 83 760 dollars. Bien sûr, pendant son mandat de 2011 à 2019, elle a supervisé divers ajustements structurels sur les pays pauvres, où les taxes sur les plus vulnérables ont presque toujours été augmentées.
Graham Hancock note que les indemnités de licenciement à la Banque mondiale dans les années 1980 "atteignaient en moyenne un quart de million de dollars par personne." Lorsque 700 cadres ont perdu leur emploi en 1987, l'argent consacré à leurs parachutes dorés - 175 millions de dollars - aurait suffi, note-t-il, "à payer une éducation élémentaire complète à 63 000 enfants issus de familles pauvres d'Amérique latine ou d'Afrique."
Selon l'ancien directeur de la Banque mondiale, James Wolfensohn, de 1995 à 2005, il y a eu plus de 63000 projets de la Banque dans les pays en développement : les coûts des "études de faisabilité" et les frais de voyage et de logement des experts des pays industrialisés ont absorbé à eux seuls jusqu'à 25% du total de l'aide.
Cinquante ans après la création de la Banque et du Fonds, "90% des 12 milliards de dollars par an d'assistance technique étaient encore consacrés à l'expertise étrangère." Cette année-là, en 1994, George Ayittey notait que 80 000 consultants de la Banque travaillaient sur la seule Afrique, mais que "moins de 0,01%" étaient des Africains.
Hancock écrit que "la Banque, qui investit plus d'argent dans plus de projets dans plus de pays en développement que n'importe quelle autre institution, prétend qu'elle "cherche à répondre aux besoins des plus pauvres", mais à aucun moment de ce qu'elle appelle le "cycle du projet", elle ne prend le temps de demander aux pauvres eux-mêmes comment ils perçoivent leurs besoins... les pauvres sont entièrement écartés du processus décisionnel - presque comme s'ils n'existaient pas".
La politique de la Banque et du Fonds est forgée lors de réunions dans des hôtels somptueux entre des personnes qui n'auront jamais à vivre un jour dans la pauvreté de leur vie. Comme l'affirme Joseph Stiglitz dans sa propre critique de la Banque et du Fonds, "la guerre moderne de haute technologie est conçue pour supprimer le contact physique : lâcher des bombes à 50 000 pieds d'altitude garantit que l'on ne "sent" pas ce que l'on fait. La gestion économique moderne est similaire : depuis son hôtel de luxe, on peut imposer sans ménagement des politiques auxquelles on réfléchirait à deux fois si on connaissait les personnes dont on détruit la vie."
Il est frappant de constater que les dirigeants de la Banque et du Fonds sont parfois ceux-là mêmes qui lâchent les bombes. Par exemple, Robert McNamara - probablement la personne la plus transformatrice de l'histoire de la Banque, célèbre pour avoir augmenté massivement ses prêts et enfoncé les pays pauvres dans une dette inéluctable - a d'abord été PDG de la société Ford, avant de devenir secrétaire américain à la défense, où il a envoyé 500000 soldats américains combattre au Vietnam. Après avoir quitté la Banque, il est entré directement au conseil d'administration de Royal Dutch Shell. Un dirigeant plus récent de la Banque mondiale était Paul Wolfowitz, l'un des principaux architectes de la guerre en Irak.
Les responsables du développement prennent leurs décisions loin des populations qui finissent par en ressentir les effets, et ils cachent les détails derrière des montagnes de paperasse, de rapports et de jargon euphémique. À l'instar de l'ancien ministère britannique des Colonies, le groupe se dissimule "comme une seiche, dans un nuage d'encre".
Les histoires prolifiques et épuisantes écrites par le groupe sont des hagiographies : l'expérience humaine est effacée. Un bon exemple est une étude intitulée "Ajustement de la balance des paiements, 1945 à 1986 : The IMF Experience". Cet auteur a fait l'expérience fastidieuse de lire l'intégralité de ce tome. Les bénéfices du colonialisme sont entièrement ignorés. Les histoires personnelles et les expériences humaines des personnes qui ont souffert de la politique de la Banque et du Fonds sont éludées. Les souffrances sont enterrées sous d'innombrables graphiques et statistiques. Ces études, qui dominent le discours, se lisent comme si leur principale priorité était d'éviter d'offenser le personnel de la Banque ou du Fonds. Bien sûr, le ton implique que des erreurs ont peut-être été commises ici ou là, mais les intentions de la Banque et du Fonds sont bonnes. Ils sont là pour aider.
Dans un exemple tiré de l'étude susmentionnée, l'ajustement structurel en Argentine en 1959 et 1960 est décrit comme suit : "Si ces mesures avaient initialement réduit le niveau de vie d'un vaste secteur de la population argentine, elles avaient permis, en relativement peu de temps, d'obtenir une balance commerciale et une balance des paiements favorables, une augmentation des réserves de change, une forte réduction du taux d'augmentation du coût de la vie, un taux de change stable et une augmentation des investissements nationaux et étrangers."
En termes simples : Bien sûr, il y a eu un énorme appauvrissement de l'ensemble de la population, mais hé, nous avons obtenu un meilleur bilan, plus d'économies pour le régime, et plus d'accords avec les sociétés multinationales.
Les euphémismes se multiplient. Les pays pauvres sont systématiquement décrits comme des "cas types". Le lexique, le jargon et le langage de l'économie du développement sont conçus pour cacher ce qui se passe réellement, pour masquer la cruelle réalité par des termes, des processus et des théories, et pour éviter d'énoncer le mécanisme sous-jacent : les pays riches siphonnent les ressources des pays pauvres et bénéficient de deux poids deux mesures qui enrichissent leurs populations tout en appauvrissant les autres.
L'apothéose de la relation de la Banque et du Fonds avec le monde en développement est leur réunion annuelle à Washington, D.C. : un grand festival sur la pauvreté dans le pays le plus riche de la planète.
"Sur des montagnes de nourriture magnifiquement préparée", écrit Hancock, "d'énormes volumes d'affaires sont traités ; pendant ce temps, des démonstrations stupéfiantes de domination et d'ostentation se mêlent doucement à une rhétorique vide et sans signification sur la situation difficile des pauvres".
"Les 10 000 hommes et femmes présents, écrit-il, ont très peu de chances d'atteindre leurs nobles objectifs ; lorsqu'ils ne bâillent pas ou ne s'endorment pas lors des sessions plénières, on les trouve en train de profiter d'une série de cocktails, de déjeuners, de thés de l'après-midi, de dîners et de collations de minuit assez somptueux pour combler le plus vert des gourmands. Le coût total des 700 événements sociaux organisés pour les délégués au cours d'une seule semaine [en 1989] a été estimé à 10 millions de dollars - une somme d'argent qui aurait peut-être mieux servi les besoins des pauvres si elle avait été dépensée d'une autre manière".
C'était il y a 33 ans : on ne peut qu'imaginer le coût de ces fêtes en dollars d'aujourd'hui.
Dans son livre "The Fiat Standard", Saifedean Ammous donne un autre nom à l'ensemble du développement : l'industrie de la misère. Sa description mérite d'être citée en détail :
"Lorsque la planification de la Banque mondiale échoue inévitablement et que les dettes ne peuvent être remboursées, le FMI intervient pour secouer les pays mauvais payeurs, piller leurs ressources et prendre le contrôle des institutions politiques. Il s'agit d'une relation symbiotique entre les deux organisations parasites qui génère beaucoup de travail, de revenus et de voyages pour les travailleurs de l'industrie de la misère - aux dépens des pays pauvres qui doivent payer tout cela en prêts."
"Plus on lit sur le sujet", écrit Ammous, "plus on réalise à quel point il a été catastrophique de remettre à cette classe de bureaucrates puissants mais non responsables une ligne sans fin de crédit fiat et de les lâcher sur les pauvres du monde. Cet arrangement permet à des étrangers non élus et sans enjeu de contrôler et de planifier de manière centralisée l'économie de nations entières..... Les populations indigènes sont chassées de leurs terres, les entreprises privées sont fermées pour protéger les droits de monopole, les impôts sont augmentés et les biens sont confisqués... des accords d'exonération fiscale sont accordés aux entreprises internationales sous les auspices des institutions financières internationales, tandis que les producteurs locaux paient des impôts toujours plus élevés et souffrent de l'inflation pour satisfaire l'incontinence fiscale de leurs gouvernements."
"Dans le cadre des accords d'allègement de la dette signés avec l'industrie de la misère, poursuit-il, les gouvernements ont été invités à vendre certains de leurs actifs les plus précieux. Il s'agissait d'entreprises publiques, mais aussi de ressources nationales et de pans entiers de territoire. Le FMI vendait généralement ces biens aux enchères à des sociétés multinationales et négociait avec les gouvernements pour qu'ils soient exemptés des taxes et des lois locales. Après avoir saturé le monde de crédits faciles pendant des décennies, les IFI ont passé les années 1980 à jouer les repo-managers. Elles ont fouillé dans les décombres des pays du tiers-monde dévastés par leurs politiques et ont vendu tout ce qui avait de la valeur aux multinationales, leur offrant une protection contre la loi dans les tas de ferraille où elles opéraient. Cette redistribution à l'envers de Robin des Bois était la conséquence inévitable de la dynamique créée lorsque ces organisations étaient dotées d'argent facile."
"En veillant à ce que le monde entier reste sur l'étalon dollar américain", conclut Ammous, "le FMI garantit que les États-Unis peuvent continuer à appliquer leur politique monétaire inflationniste et à exporter leur inflation dans le monde entier". Ce n'est que lorsqu'on comprend le grand larcin au cœur du système monétaire mondial que l'on peut comprendre la situation critique des pays en développement."
X. Les Éléphants Blancs
"Ce que l'Afrique doit faire, c'est croître, croître pour sortir de la dette".
- George Ayittey
Au milieu des années 1970, il était clair pour les décideurs occidentaux, et surtout pour le président de la Banque, Robert McNamara, que la seule façon pour les pays pauvres de rembourser leur dette était de s'endetter davantage.
Le FMI a toujours associé ses prêts à l'ajustement structurel, mais au cours de ses premières décennies, la Banque accordait des prêts spécifiques à un projet ou à un secteur, sans conditions supplémentaires. Cette situation a changé pendant le mandat de McNamara, les prêts d'ajustement structurel moins spécifiques devenant populaires et même dominants à la Banque dans les années 1980.
La raison en était assez simple : les employés de la Banque avaient beaucoup plus d'argent à prêter, et il était plus facile de distribuer de grosses sommes si l'argent n'était pas lié à des projets spécifiques. Comme le fait remarquer M. Payer, "deux fois plus de dollars par semaine de travail du personnel" pouvaient être déboursés grâce aux prêts d'ajustement structurel.
Les emprunteurs, selon Hancock, ne pouvaient pas être plus heureux : "Les ministres des finances corrompus et les présidents dictatoriaux d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont trébuché sur leurs propres chaussures coûteuses dans leur empressement inconvenant à s'adapter. Pour ces personnes, l'argent n'a probablement jamais été aussi facile à obtenir : sans projets compliqués à gérer et sans comptes désordonnés à tenir, les vénaux, les cruels et les laids ont littéralement ri jusqu'à la banque. Pour eux, l'ajustement structurel était comme un rêve devenu réalité. Aucun sacrifice n'était exigé d'eux personnellement. Tout ce qu'ils avaient à faire - incroyable mais vrai - était d'entuber les pauvres."
Au-delà des prêts d'ajustement structurel "d'usage général", l'autre façon de dépenser de grandes quantités d'argent consistait à financer des projets massifs et individuels. Ces projets seront connus sous le nom d'"éléphants blancs", et leurs carcasses parsèment encore les déserts, les montagnes et les forêts du monde en développement. Ces mastodontes étaient connus pour leur dévastation humaine et environnementale.
Un bon exemple est celui des barrages d'Inga, construits au Zaïre en 1972, dont les architectes financés par la Banque ont électrifié l'exploitation de la province du Katanga, riche en minerais, sans installer aucun transformateur en cours de route pour aider les nombreux villageois qui utilisaient encore des lampes à huile. Ou encore l'oléoduc Tchad-Cameroun dans les années 1990 : ce projet de 3,7 milliards de dollars, financé par la Banque, a été entièrement construit pour siphonner les ressources du sol afin d'enrichir la dictature de Deby et ses collaborateurs étrangers, sans aucun bénéfice pour la population. Entre 1979 et 1983, les projets hydroélectriques financés par la Banque "ont entraîné la réinstallation involontaire d'au moins 400 000 à 450 000 personnes sur quatre continents."
Hancock détaille de nombreux éléphants blancs de ce type dans "Lords Of Poverty". Un exemple est le complexe énergétique et minier de Singrauli, dans l'État indien de l'Uttar Pradesh, qui a reçu près d'un milliard de dollars de financement de la Banque.

"Ici, écrit Hancock, en raison du "développement", 300 000 pauvres ruraux ont été soumis à de fréquents déplacements forcés au fur et à mesure de l'ouverture de nouvelles mines et centrales électriques... la terre était totalement détruite et ressemblait à des scènes tirées des cercles inférieurs de l'enfer de Dante. D'énormes quantités de poussière et de pollution de l'air et de l'eau de toutes sortes ont créé d'énormes problèmes de santé publique. La tuberculose était endémique, les réserves d'eau potable détruites et la malaria résistante à la chloroquine affligeait la région. Des villages et hameaux autrefois prospères ont été remplacés par d'innommables masures et cabanes en bordure d'énormes projets d'infrastructure... certaines personnes vivaient à l'intérieur des mines à ciel ouvert. Plus de 70 000 paysans auparavant autosuffisants - privés de toutes les sources de revenus possibles - n'ont eu d'autre choix que d'accepter l'indignité d'un emploi intermittent à Singrauli pour des salaires d'environ 70 cents par jour : en dessous du niveau de survie, même en Inde."
Au Guatemala, Hancock décrit un barrage hydroélectrique géant appelé le Chixoy, construit avec le soutien de la Banque mondiale dans les hauts plateaux mayas.
"Budgété à l'origine à 340 millions de dollars", écrit-il, "les coûts de construction étaient passés à 1 milliard de dollars au moment de l'ouverture du barrage en 1985... l'argent a été prêté au gouvernement guatémaltèque par un consortium [dirigé] par la Banque mondiale.... Le gouvernement militaire du général Romero Lucas Arica, au pouvoir pendant la majeure partie de la phase de construction et qui a signé le contrat avec la Banque mondiale, a été reconnu par les analystes politiques comme ayant été l'administration la plus corrompue de l'histoire d'un pays d'Amérique centrale dans une région qui a été affligée par plus que sa part de régimes vénaux et malhonnêtes... les membres de la junte ont empoché environ 350 millions de dollars sur le milliard fourni pour Chixoy. "
Enfin, au Brésil, Hancock détaille l'un des projets les plus néfastes de la Banque, un " plan massif de colonisation et de réinstallation " connu sous le nom de Polonoroeste. En 1985, la Banque avait engagé 434,3 millions de dollars dans cette initiative, qui a fini par transformer "les pauvres en réfugiés sur leur propre terre".
Le programme "a persuadé des centaines de milliers de personnes dans le besoin d'émigrer des provinces centrales et méridionales du Brésil et de se réinstaller comme agriculteurs dans le bassin amazonien" pour générer des cultures commerciales. "L'argent de la Banque, écrit M. Hancock, a servi à payer l'asphaltage rapide de la route BR-364, qui pénètre au cœur de la province de Rondonia, dans le nord-ouest du pays. Tous les colons ont emprunté cette route pour se rendre dans les fermes qu'ils ont abattues et brûlées dans la jungle... Déjà déboisée à 4 % en 1982, la Rondonia l'était à 11 % en 1985. Les relevés spatiaux de la NASA ont montré que la superficie de la déforestation doublait tous les deux ans environ."
À la suite de ce projet, en 1988, "des forêts tropicales couvrant une superficie plus grande que la Belgique ont été brûlées par les colons." Hancock note également que "plus de 200 000 colons auraient contracté une souche particulièrement virulente de malaria, endémique dans le nord-ouest, à laquelle ils n'avaient aucune résistance."
Ces projets grotesques étaient le résultat de la croissance massive des institutions de prêt, d'un détachement des créanciers des lieux réels auxquels ils prêtaient, et d'une gestion par des autocrates locaux n'ayant aucun compte à rendre et empochant des milliards au passage. Elles sont le résultat de politiques qui ont tenté de prêter autant d'argent que possible aux pays du tiers-monde afin de maintenir le Ponzi de la dette et le flux de ressources du sud vers le nord. L'exemple le plus affreux de tous se trouve peut-être en Indonésie.
XI. Un Pandore De La Vie Réelle : L'exploitation De La Papouasie Occidentale
"Si vous voulez un accord équitable, vous êtes sur la mauvaise planète."
- Jake Sully
L'île de Nouvelle-Guinée est riche en ressources au-delà de toute imagination. On y trouve, pour commencer: la troisième plus grande étendue de forêt tropicale du monde, après l'Amazonie et le Congo ; la plus grande mine d'or et de cuivre du monde, Grasberg, à l'ombre du pic "Seven Summit" de 4 800 mètres de Puncak Jaya ; et, au large, le Triangle de Corail, une mer tropicale connue pour la diversité "inégalée" de ses récifs.
Et pourtant, les habitants de l'île, en particulier ceux qui vivent dans la moitié occidentale de l'île, de la taille de la Californie, sous contrôle indonésien, sont parmi les plus pauvres du monde. Le colonialisme des ressources a longtemps été une malédiction pour les habitants de ce territoire, connu sous le nom de Papouasie occidentale. Que le pillage ait été commis par les Hollandais ou, plus récemment, par le gouvernement indonésien, les impérialistes ont trouvé un soutien généreux auprès de la Banque et du Fonds.
Cet essai a déjà mentionné comment l'un des premiers prêts de la Banque mondiale a été accordé aux Néerlandais, qu'elle a utilisé pour tenter de maintenir son empire colonial en Indonésie. En 1962, la Hollande impériale a finalement été vaincue et a cédé le contrôle de la Papouasie occidentale au gouvernement Sukarno, l'Indonésie devenant indépendante. Cependant, les Papous (également connus sous le nom d'Irianais) voulaient leur propre liberté.
Au cours de cette décennie - alors que le FMI créditait le gouvernement indonésien de plus de 100 millions de dollars - les Papous ont été éliminés des postes de direction. En 1969, lors d'un événement qui ferait rougir l'Océanie de George Orwell, Jakarta a organisé l'"Acte de libre choix", un scrutin au cours duquel 1025 personnes ont été rassemblées et forcées de voter devant des soldats armés. Les résultats en faveur de l'adhésion à l'Indonésie ont été unanimes, et le vote a été ratifié par l'Assemblée générale des Nations unies. Après cela, les habitants n'ont plus eu leur mot à dire sur les projets de "développement". Le pétrole, le cuivre et le bois ont tous été récoltés et évacués de l'île au cours des décennies suivantes, sans aucune participation des Papous, si ce n'est sous forme de travail forcé.
Les mines, les autoroutes et les ports de Papouasie occidentale n'ont pas été construits dans l'optique du bien-être de la population, mais plutôt pour piller l'île aussi efficacement que possible. Comme Payer a pu le constater même en 1974, le FMI a contribué à transformer les vastes ressources naturelles de l'Indonésie en "hypothèques pour un avenir indéfini afin de subventionner une dictature militaire oppressive et de payer les importations qui soutenaient le style de vie somptueux des généraux de Jakarta."
Un article de 1959 sur la découverte d'or dans la région est le début de l'histoire de ce qui deviendra plus tard la mine de Grasberg, le producteur de cuivre et d'or le plus important et le moins cher du monde. En 1972, la société Freeport, basée à Phoenix, a signé un accord avec le dictateur indonésien Suharto pour extraire de l'or et du cuivre en Papouasie occidentale, sans aucun consentement de la population indigène. Jusqu'en 2017, Freeport contrôlait 90 % des parts du projet, 10 % revenant au gouvernement indonésien et 0 % aux tribus Amungme et Kamoro qui habitent effectivement la région.

Lorsque les trésors de Grasberg auront été entièrement épuisés par la société Freeport, le projet aura généré quelque six milliards de tonnes de déchets, soit plus de deux fois la quantité de roche extraite pour creuser le canal de Panama.
Les écosystèmes situés en aval de la mine ont depuis été dévastés et privés de vie, car plus d'un milliard de tonnes de déchets ont été déversés "directement dans une rivière de la jungle, dans ce qui était l'un des derniers paysages vierges du monde". Des rapports satellites montrent la dévastation causée par le déversement continu de plus de 200 000 tonnes de résidus toxiques par jour dans une zone qui contient le parc national de Lorentz, un site du patrimoine mondial. Freeport reste le plus gros contribuable étranger en Indonésie et le plus gros employeur en Papouasie occidentale : il prévoit de rester jusqu'en 2040, date à laquelle l'or sera épuisé.
Comme l'écrit candidement la Banque mondiale dans son propre rapport sur la région, "les intérêts commerciaux internationaux veulent de meilleures infrastructures afin d'extraire et d'exporter les actifs minéraux et forestiers non renouvelables."
Le programme de loin le plus choquant que la Banque a financé en Papouasie occidentale était la "transmigration", un euphémisme pour le colonialisme de peuplement. Pendant plus d'un siècle, les puissances qui contrôlaient Java (où vit la majeure partie de la population indonésienne) ont rêvé de déplacer de grandes quantités de Javanais vers des îles plus éloignées de l'archipel. Non seulement pour répartir la population, mais aussi pour "unifier" idéologiquement le territoire. Dans un discours prononcé en 1985, le ministre de la Transmigration a déclaré que "par le biais de la transmigration, nous essaierons ... d'intégrer tous les groupes ethniques dans une seule nation, la nation indonésienne ... Les différents groupes ethniques disparaîtront à long terme en raison de l'intégration ... il y aura un seul type d'homme".
Ces efforts pour réinstaller les Javanais - connus sous le nom de "Transmigrasi" - ont commencé à l'époque coloniale, mais dans les années 1970 et 1980, la Banque mondiale a commencé à financer ces activités de manière agressive. La Banque a alloué des centaines de millions de dollars à la dictature de Suharto pour lui permettre de "transmigrer" ce que l'on espérait être des millions de personnes vers des endroits comme le Timor oriental et la Papouasie occidentale dans ce qui était "le plus grand exercice de réinstallation humaine jamais réalisé dans le monde". En 1986, la Banque avait engagé pas moins de 600 millions de dollars directement pour soutenir la transmigration, ce qui impliquait "une combinaison époustouflante de violations des droits de l'homme et de destruction de l'environnement."
Prenons l'histoire du palmier sagou, l'un des principaux aliments traditionnels des Papous. Un seul arbre était capable de fournir de la nourriture à une famille pendant six à douze mois. Mais le gouvernement indonésien, encouragé par la Banque, est venu et a dit non, cela ne marche pas : vous devez manger du riz. Et donc les jardins de sagoutiers ont été coupés pour cultiver du riz pour l'exportation. Et les habitants ont été forcés d'acheter du riz sur le marché, ce qui les a simplement rendus plus dépendants de Jakarta.
Toute résistance était accueillie avec brutalité. Surtout sous Suharto - qui a détenu jusqu'à 100,000 prisonniers politiques - mais encore aujourd'hui en 2022, la Papouasie occidentale est un État policier presque sans rival. Les journalistes étrangers sont pratiquement interdits ; la liberté d'expression n'existe pas ; les militaires opèrent sans avoir à rendre de comptes. Des ONG comme Tapol documentent une légion de violations des droits de l'homme, allant de la surveillance massive des appareils personnels aux restrictions sur le moment et la raison pour lesquels les gens peuvent quitter leur domicile, en passant par les règles sur la façon dont les Papous peuvent porter leurs cheveux.
Entre 1979 et 1984, quelque 59,700 transmigrants ont été emmenés en Papouasie occidentale, avec le soutien "à grande échelle" de la Banque mondiale. Plus de 20,000 Papous ont fui les violences vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée voisine. Les réfugiés ont rapporté aux médias internationaux que "leurs villages ont été bombardés, leurs établissements brûlés, les femmes violées, le bétail tué, et un certain nombre de personnes abattues sans discernement tandis que d'autres étaient emprisonnées et torturées".
Un projet ultérieur, soutenu par un prêt de 160 millions de dollars de la Banque en 1985, s'appelait "Transmigration V" : septième projet financé par la Banque en faveur du colonialisme de peuplement, il visait à financer la réinstallation de 300 000 familles entre 1986 et 1992. Le gouverneur du régime de Papouasie occidentale de l'époque décrivait la population indigène comme "vivant à l'âge de pierre" et demandait que deux millions de migrants javanais supplémentaires soient envoyés dans les îles afin que "les populations locales arriérées puissent se marier avec les nouveaux arrivants, donnant ainsi naissance à une nouvelle génération de personnes sans cheveux bouclés".
La version originale et la version finale de l'accord de prêt Transmigration V ont fait l'objet d'une fuite à Survival International : la version originale fait "largement référence aux politiques de la banque sur les peuples tribaux et fournit une liste de mesures qui seraient nécessaires pour s'y conformer", mais la version finale ne fait "aucune référence aux politiques de la banque."
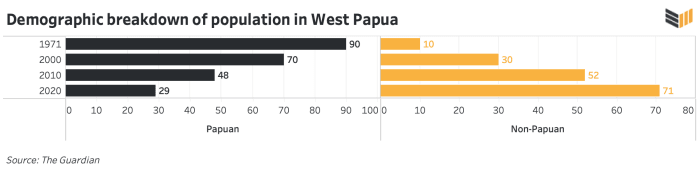
La transmigration V s'est heurtée à des problèmes budgétaires et a été écourtée, mais au final 161 600 familles ont été déplacées, au prix de 14 146 mois de travail pour la Banque. La Banque finançait clairement un génocide culturel : aujourd'hui, les Papous ethniques ne représentent pas plus de 30% de la population du territoire. Mais l'ingénierie sociale n'était pas le seul objectif de l'argent de la Banque : On estime que 17 % des fonds destinés aux projets de transmigration ont été volés par des fonctionnaires du gouvernement.
Quinze ans plus tard, le 11 décembre 2001, la Banque mondiale a approuvé un prêt de 200 millions de dollars pour "améliorer les conditions routières" en Papouasie occidentale et dans d'autres régions de l'Indonésie orientale. Le projet, connu sous le nom d'EIRTP, visait à "améliorer l'état des routes nationales et d'autres artères stratégiques afin de réduire les coûts de transport et de fournir un accès plus fiable entre les centres provinciaux, les zones de développement et de production régionales, et d'autres installations de transport clés. Selon la Banque, "la réduction des coûts de transport routier contribuera à faire baisser les prix des intrants, à augmenter les prix à la production et à accroître la compétitivité des produits locaux des zones touchées." En d'autres termes, la Banque aidait à extraire les ressources le plus efficacement possible.
L'histoire de la Banque et du Fonds en Indonésie est tellement scandaleuse qu'elle semble provenir d'un autre temps, d'une autre époque. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Entre 2003 et 2008, la Banque a financé le développement de l'huile de palme en Indonésie à hauteur de près de 200 millions de dollars et a engagé des entreprises privées qui auraient "utilisé le feu pour défricher des forêts primaires et s'emparer de terres appartenant à des populations autochtones sans procédure régulière".
Aujourd'hui, le gouvernement indonésien reste redevable du prêt EIRTP. Au cours des cinq dernières années, la Banque a perçu 70 millions de dollars en paiements d'intérêts de la part du gouvernement et des contribuables indonésiens, tout cela pour ses efforts visant à accélérer l'extraction des ressources d'îles comme la Papouasie occidentale.
XII. Le Plus Grand Ponzi Du Monde
"Les pays ne font pas faillite."
- Walter Wriston, ancien président de la Citibank.
On pourrait considérer la faillite comme une partie importante et même essentielle du capitalisme. Mais le FMI existe essentiellement pour empêcher le marché libre de fonctionner comme il le ferait normalement : il renfloue les pays qui devraient normalement faire faillite, les forçant au contraire à s'endetter davantage.
Le FMI rend possible l'impossible : les petits pays pauvres ont tellement de dettes qu'ils ne pourront jamais tout rembourser. Ces renflouements corrompent les incitations du système financier mondial. Dans un véritable marché libre, les prêts à risque auraient de graves conséquences : la banque créancière pourrait perdre son argent.
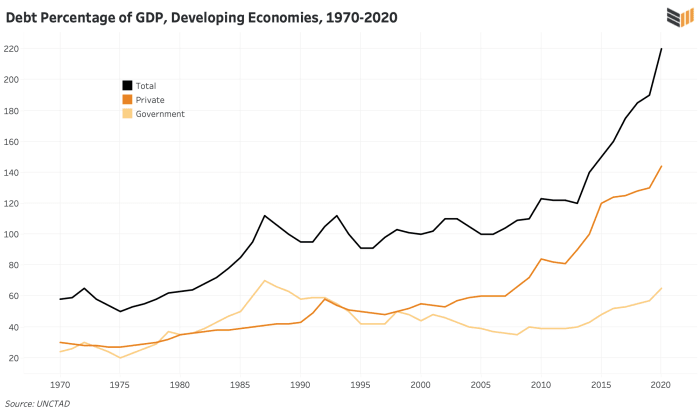
Lorsque les États-Unis, l'Europe ou le Japon ont effectué leurs dépôts à la Banque et au Fonds, cela revenait à acheter une assurance sur leur capacité à extraire des richesses des nations en développement. Leurs banques privées et leurs sociétés multinationales sont protégées par le plan de sauvetage et, en plus, elles perçoivent des intérêts élevés et réguliers (payés par les pays pauvres) sur ce qui est largement perçu comme une aide humanitaire.
Comme l'écrit David Graeber dans "Debt", lorsque les banques "ont prêté de l'argent aux dictateurs de Bolivie et du Gabon à la fin des années 70 : [elles ont fait] des prêts totalement irresponsables en sachant parfaitement qu'une fois que l'on saurait qu'elles l'avaient fait, les politiciens et les bureaucrates se précipiteraient pour s'assurer qu'elles seraient quand même remboursées, peu importe le nombre de vies dévastées et détruites pour y parvenir".
Kevin Danaher décrit la tension qui a commencé à émerger dans les années 1960 : "Les emprunteurs ont commencé à rembourser annuellement à la Banque plus que ce qu'elle déboursait en nouveaux prêts. En 1963, 1964 et 1969, l'Inde a transféré plus d'argent à la Banque mondiale que la Banque ne lui en a versé." Techniquement, l'Inde remboursait ses dettes plus les intérêts, mais les dirigeants de la Banque voyaient une crise.
"Pour résoudre le problème", poursuit Danaher, le président de la Banque, Robert McNamara, a augmenté les prêts "à un rythme phénoménal, passant de 953 millions de dollars en 1968 à 12,4 milliards de dollars en 1981." Le nombre de programmes de prêts du FMI a également "plus que doublé" entre 1976 et 1983, principalement en faveur des pays pauvres. Les assurances de la Banque et du Fonds ont conduit les titanesques banques centrales du monde ainsi que des centaines de banques régionales et locales aux États-Unis et en Europe - "la plupart d'entre elles ayant peu ou pas d'antécédents en matière de prêts à l'étranger" - à se lancer dans une frénésie de prêts sans précédent.
La bulle de la dette du tiers monde a finalement éclaté en 1982, lorsque le Mexique a annoncé un défaut de paiement. Selon l'histoire officielle du FMI, "les banquiers privés ont envisagé la possibilité redoutée d'une répudiation généralisée des dettes, comme cela s'était produit dans les années 1930 : à l'époque, la dette des pays débiteurs envers les pays industrialisés se présentait principalement sous la forme de titres émis par les pays débiteurs aux États-Unis et sous la forme d'obligations vendues à l'étranger ; dans les années 1980, la dette se présentait presque entièrement sous la forme de prêts à court et moyen terme accordés par les banques commerciales des membres industrialisés. Les autorités monétaires des membres industriels ont instantanément pris conscience de l'urgence du problème posé au système bancaire mondial."
En d'autres termes : la menace que les banques de l'Ouest aient des trous dans leur bilan était le danger : pas que des millions de personnes meurent des programmes d'austérité dans les pays pauvres. Dans son livre "A Fate Worse Than Debt", la critique du développement Susan George montre comment les neuf plus grandes banques américaines ont placé plus de 100 % de leurs fonds propres dans des "prêts au Mexique, au Brésil, à l'Argentine et au Venezuela". La crise a cependant été évitée, car le FMI a aidé le crédit à circuler dans les pays du tiers-monde, même s'ils auraient dû faire faillite.
"En termes simples", selon une analyse technique du Fonds, ses programmes "fournissent des renflouements aux prêteurs privés des marchés émergents, permettant ainsi aux créanciers internationaux de bénéficier de prêts étrangers sans supporter l'intégralité des risques encourus : les banques récoltent des bénéfices importants si les emprunteurs remboursent leurs dettes et évitent les pertes en cas de crise financière."
Les citoyens d'Amérique latine ont souffert de l'ajustement structurel, mais entre 1982 et 1985. George rapporte que "malgré une surexposition à l'Amérique latine, les dividendes déclarés par les neuf grandes banques ont augmenté de plus d'un tiers au cours de la même période." Pendant cette période, les bénéfices ont augmenté de 84% chez Chase Manhattan et de 66% chez Banker's Trust, et la valeur des actions a augmenté de 86% chez Chase et de 83% chez Citicorp.
"Il est clair, écrit-elle, que l'austérité n'est pas le terme qui convient pour décrire les expériences vécues depuis 1982 par l'élite du tiers-monde ou par les banques internationales : les parties qui ont contracté les prêts en premier lieu."
La "générosité" de l'Occident a permis à des dirigeants n'ayant aucun compte à rendre de plonger leurs nations dans une dette plus profonde que jamais. Le système était, comme l'écrit Payer dans "Lent And Lost", une simple chaîne de Ponzi : les nouveaux prêts servaient directement à payer les anciens. Le système avait besoin de croître pour éviter l'effondrement.
"En maintenant le financement", a déclaré un directeur général du FMI, selon Payer, les prêts d'ajustement structurel "ont permis des échanges qui, autrement, n'auraient peut-être pas été possibles."
Étant donné que la Banque et le Fonds empêcheront même les gouvernements les plus comiquement corrompus et gaspilleurs de faire faillite, les banques privées ont adapté leur comportement en conséquence. Un bon exemple serait l'Argentine, qui a reçu 22 prêts du FMI depuis 1959, et qui a même essayé de faire défaut en 2001. On pourrait penser que les créanciers cesseraient de prêter à un emprunteur aussi prodigue. Mais en fait, il y a quatre ans à peine, l'Argentine a reçu le plus gros prêt du FMI de tous les temps, soit la somme faramineuse de 57,1 milliards de dollars.
Mme Payer résume "Le piège de la dette" en déclarant que la morale de son ouvrage est "à la fois simple et démodée : les nations, comme les individus, ne peuvent dépenser plus qu'elles ne gagnent sans s'endetter, et un lourd fardeau de la dette barre la route à l'action autonome".
Mais le système rend l'affaire trop douce pour les créanciers : les profits sont monopolisés tandis que les pertes sont socialisées.
Payer s'en est rendu compte il y a 50 ans déjà, en 1974, et a donc conclu qu'"à long terme, il est plus réaliste de se retirer d'un système d'exploitation et de subir les bouleversements d'un réajustement que de demander aux exploiteurs un certain soulagement".
XIII. Faites Ce Que Je Dis, Pas Ce Que Je Fais
"Notre style de vie n'est pas négociable".
- George H.W. Bush
Dans un véritable marché libre mondial, les politiques que la Banque et le Fonds imposent aux pays pauvres pourraient avoir un sens. Après tout, le bilan du socialisme et de la nationalisation à grande échelle de l'industrie est désastreux. Le problème est que le monde n'est pas un marché libre et que les doubles standards sont partout.
Les subventions - par exemple, le riz gratuit au Sri Lanka ou le carburant à prix réduit au Nigeria - sont supprimées par le FMI, mais des pays créanciers comme le Royaume-Uni et les États-Unis offrent des soins de santé financés par l'État et des subventions aux cultures à leurs propres populations.
On peut adopter un point de vue libertaire ou marxiste et arriver à la même conclusion : il s'agit d'un système de deux poids, deux mesures qui enrichit certains pays aux dépens d'autres, la plupart des citoyens des pays riches en étant parfaitement inconscients.
Pour aider les pays à se relever des décombres de la Seconde Guerre mondiale, les créanciers du FMI se sont largement appuyés sur la planification centrale et la politique anti-marché libre pendant les premières décennies qui ont suivi Bretton Woods : par exemple, les restrictions à l'importation, les limites aux sorties de capitaux, les plafonds de change et les subventions aux cultures. Ces mesures ont protégé les économies industrielles au moment où elles étaient le plus vulnérables.
Aux États-Unis, par exemple, la loi sur l'égalisation des intérêts a été adoptée par John F. Kennedy pour empêcher les Américains d'acheter des titres étrangers et les orienter plutôt vers des investissements nationaux. C'était l'une des nombreuses mesures visant à renforcer le contrôle des capitaux. Mais la Banque et le Fonds ont historiquement empêché les pays pauvres d'utiliser les mêmes tactiques pour se défendre.
Comme l'observe Payer, "le FMI n'a jamais joué un rôle décisif dans l'ajustement des taux de change et des pratiques commerciales parmi les nations développées riches... Ce sont les nations plus faibles qui sont soumises à toute la force des principes du FMI... l'inégalité des relations de pouvoir signifiait que le Fonds ne pouvait rien faire contre les "distorsions" du marché (comme la protection commerciale) qui étaient pratiquées par les pays riches."
Vásquez et Bandow, de Cato, sont arrivés à une conclusion similaire, en notant que "la plupart des nations industrialisées ont maintenu une attitude condescendante envers les nations sous-développées, fermant hypocritement leurs exportations."
Au début des années 1990, alors que les États-Unis soulignaient l'importance du libre-échange, ils ont "érigé un rideau de fer virtuel contre les exportations [de l'Europe de l'Est], notamment les textiles, l'acier et les produits agricoles." La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine et l'Ouzbékistan étaient tous visés. Les États-Unis ont empêché les nations d'Europe de l'Est de vendre "une seule livre de beurre, de lait sec ou de crème glacée en Amérique" et les administrations Bush et Clinton ont imposé de sévères restrictions aux importations de produits chimiques et pharmaceutiques dans la région.
On estime que le protectionnisme des pays industriels "réduit le revenu national des pays en développement d'environ deux fois plus que ce que leur apporte l'aide au développement". En d'autres termes, si les nations occidentales ouvraient simplement leurs économies, elles n'auraient pas à fournir la moindre aide au développement.
Cet arrangement comporte un aspect sinistre : lorsqu'un pays occidental (c'est-à-dire les États-Unis) traverse une crise inflationniste - comme celle d'aujourd'hui - et est contraint de resserrer sa politique monétaire, il acquiert en fait un contrôle accru sur les pays en développement et leurs ressources, dont la dette en dollars devient beaucoup plus difficile à rembourser, et qui tombent plus profondément dans le piège de la dette, et plus profondément dans la conditionnalité de la Banque et du Fonds.
En 2008, lors de la grande crise financière, les autorités américaines et européennes ont baissé les taux d'intérêt et alimenté les banques en liquidités supplémentaires. Pendant la crise de la dette du tiers monde et la crise financière asiatique, la Banque et le Fonds ont refusé d'autoriser ce type de comportement. Au lieu de cela, ils ont recommandé aux économies touchées de se resserrer au niveau national et d'emprunter davantage à l'étranger.
En septembre 2022, les journaux ont titré que le FMI était "inquiet" de l'inflation au Royaume-Uni, alors que son marché obligataire vacillait au bord de l'effondrement. Il s'agit bien sûr d'une autre hypocrisie, étant donné que le FMI ne semblait pas s'inquiéter de l'inflation lorsqu'il imposait la dévaluation de la monnaie à des milliards de personnes pendant des décennies. Les nations créancières jouent selon des règles différentes.
Dans un dernier cas de "faites ce que je dis, mais pas ce que je fais", le FMI détient toujours la somme énorme de 90,5 millions d'onces - ou 2814 tonnes métriques - d'or. La majeure partie de ces réserves a été accumulée dans les années 1940, lorsque les membres ont été contraints de payer 25 % de leurs quotes-parts initiales en or. En fait, jusque dans les années 1970, les membres "payaient normalement en or tous les intérêts dus sur les crédits du FMI".
Lorsque Richard Nixon a officiellement mis fin à l'étalon-or en 1971, le FMI n'a pas vendu ses réserves d'or. Et pourtant, il est interdit à tout pays membre de tenter de fixer sa monnaie à l'or.
XIV. Le Colonialisme Vert
"Si vous coupiez l'électricité pendant quelques mois dans n'importe quelle société occidentale développée, 500 ans de supposés progrès philosophiques sur les droits de l'homme et l'individualisme s'évaporeraient rapidement comme s'ils n'avaient jamais existé."
- Murtaza Hussain
Au cours des dernières décennies, un nouveau double standard est apparu : le colonialisme vert. C'est du moins ce que l'entrepreneur sénégalais Magatte Wade appelle l'hypocrisie de l'Occident en matière de consommation d'énergie dans une interview réalisée pour cet article.
Wade nous rappelle que les pays industriels ont développé leurs civilisations en utilisant des hydrocarbures (en grande partie volés ou achetés à bas prix à des pays pauvres ou à des colonies), mais qu'aujourd'hui la Banque et le Fonds tentent d'imposer des politiques qui interdisent au monde en développement de faire de même.
Alors que les États-Unis et le Royaume-Uni ont pu utiliser le charbon et le pétrole du tiers-monde, la Banque et le Fonds veulent que les pays africains utilisent l'énergie solaire et éolienne fabriquée et financée par l'Occident.
Cette hypocrisie a été mise en évidence il y a quelques semaines en Égypte, où les dirigeants mondiaux se sont réunis à l'occasion de la COP 27 (la conférence sur le changement climatique de Charm el-Cheikh) pour discuter de la manière de réduire la consommation d'énergie. L'emplacement sur le continent africain était intentionnel. Les dirigeants occidentaux - qui s'efforcent actuellement d'importer davantage de combustibles fossiles après que leur accès aux hydrocarbures russes a été restreint - sont arrivés à bord de jets privés gourmands en carburant pour implorer les pays pauvres de réduire leur empreinte carbone. Dans la tradition typique de la Banque et du Fonds, les cérémonies ont été organisées par le dictateur militaire résident. Pendant les festivités, Alaa Abd Al Fattah, un éminent militant égyptien des droits de l'homme, languissait non loin de là en grève de la faim en prison.

"Tout comme à l'époque où nous étions colonisés et où les colonisateurs fixaient les règles de fonctionnement de nos sociétés", a déclaré M. Wade, "cet agenda vert est une nouvelle forme de gouvernance. C'est le maître qui nous dicte maintenant ce que doit être notre relation avec l'énergie, qui nous dit quel type d'énergie nous devons utiliser, et quand nous pouvons l'utiliser. Le pétrole se trouve sur notre sol, il fait partie de notre souveraineté : mais maintenant ils disent que nous ne pouvons pas l'utiliser ? Même après avoir pillé des quantités incalculables pour eux-mêmes ?"
Wade souligne que dès que les pays du noyau dur connaissent une crise économique (comme c'est le cas aujourd'hui à l'approche de l'hiver 2022), ils reviennent immédiatement à l'utilisation des combustibles fossiles. Elle observe que les pays pauvres ne sont pas autorisés à développer l'énergie nucléaire, et note que lorsque les dirigeants du tiers-monde ont essayé de pousser dans cette direction par le passé, certains d'entre eux - notamment au Pakistan et au Brésil - ont été assassinés.
Mme Wade affirme que l'œuvre de sa vie est la construction de la prospérité en Afrique. Née au Sénégal, elle a déménagé en Allemagne à l'âge de sept ans. Elle se souvient encore de son premier jour en Europe. Elle était habituée à ce qu'une douche dure 30 minutes : allumer le poêle à charbon, faire bouillir l'eau, mettre de l'eau froide pour la refroidir, et transporter l'eau jusqu'à la douche. Mais en Allemagne, il lui suffisait de tourner une poignée.
"J'ai été choquée", dit-elle. "Cette question a défini le reste de ma vie : comment se fait-il qu'ils aient ça ici et que nous n'en ayons pas là-bas ?".
Wade a appris avec le temps que les raisons du succès de l'Occident comprenaient l'état de droit, des droits de propriété clairs et transférables, et des monnaies stables. Mais aussi, et c'est essentiel, un accès fiable à l'énergie.
"Nous ne pouvons pas nous laisser imposer par d'autres des limites à notre consommation d'énergie", a déclaré M. Wade. Et pourtant, la Banque et le Fonds continuent de faire pression sur la politique énergétique des pays pauvres. Le mois dernier, Haïti a suivi les pressions de la Banque et du Fonds pour mettre fin à ses subventions au carburant. "Le résultat", a écrit le journaliste spécialiste de l'énergie Michael Schellenberger, "a été des émeutes, des pillages et le chaos."
"En 2018, poursuit Michael Schellenberger, le gouvernement haïtien a accédé aux demandes du FMI de réduire les subventions aux carburants comme condition préalable à l'obtention de 96 millions de dollars de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de la Banque interaméricaine de développement, déclenchant des manifestations qui ont abouti à la démission du premier ministre."
"Dans plus de 40 nations depuis 2005, dit-il, des émeutes ont été déclenchées après la suppression des subventions aux carburants ou une autre augmentation des prix de l'énergie."
C'est le comble de l'hypocrisie pour l'Occident de réussir en s'appuyant sur une consommation d'énergie robuste et sur des subventions énergétiques, puis d'essayer de limiter le type et la quantité d'énergie utilisée par les pays pauvres et d'augmenter ensuite le prix que leurs citoyens paient. Cela équivaut à un schéma malthusien conforme à la conviction bien documentée de l'ancien directeur de la Banque mondiale, Robert McNamara, selon laquelle la croissance démographique constituait une menace pour l'humanité. La solution, bien sûr, a toujours été d'essayer de réduire la population des pays pauvres, pas des pays riches.
"Ils nous traitent comme de petites expériences", dit Wade, "où l'Occident dit : nous pourrions perdre quelques personnes en cours de route, mais voyons si les pays pauvres peuvent se développer sans les types d'énergie que nous avons utilisés."
"Eh bien", dit-elle, "nous ne sommes pas une expérience".
XV. Le Tribut Humain De L'ajustement Structurel
"Pour la Banque mondiale, le développement signifie la croissance... Mais ... la croissance effrénée est l'idéologie de la cellule cancéreuse."
- Mohammed Yunus
L'impact social de l'ajustement structurel est immense et n'est pratiquement jamais mentionné dans les analyses traditionnelles de la politique de la Banque et du Fonds. De nombreuses études exhaustives ont été réalisées sur leur impact économique, mais très peu, comparativement, sur leur impact sur la santé mondiale.
Des chercheurs comme Ayittey, Hancock et Payer donnent quelques exemples frappants des années 1970 et 1980 :
- Entre 1977 et 1985, le Pérou a entrepris l'ajustement structurel du FMI : le revenu moyen par habitant des Péruviens a chuté de 20 %, et l'inflation est passée de 30 % à 160 %. En 1985, le salaire d'un travailleur ne valait plus que 64% de ce qu'il valait en 1979 et 44% de ce qu'il valait en 1973. La malnutrition des enfants est passée de 42% à 68% de la population.
- En 1984 et 1985, les Philippines, sous Marcos, ont mis en œuvre un autre cycle de réformes structurelles du FMI : au bout d'un an, le PNB par habitant a régressé au niveau de 1975. Les revenus réels ont chuté de 46 % chez les salariés urbains.
- Au Sri Lanka, les 30 % les plus pauvres ont subi une baisse ininterrompue de leur consommation de calories après plus d'une décennie d'ajustement structurel.
- Au Brésil, le nombre de citoyens souffrant de malnutrition est passé de 27 millions (un tiers de la population) en 1961 à 86 millions (deux tiers de la population) en 1985 après 10 doses d'ajustement structurel.
- Entre 1975 et 1984, dans la Bolivie guidée par le FMI, le nombre d'heures que le citoyen moyen devait travailler pour acheter 1000 calories de pain, de haricots, de maïs, de blé, de sucre, de pommes de terre, de lait ou de quinoa a été multiplié par cinq en moyenne.
- Après l'ajustement structurel en Jamaïque en 1984, le pouvoir d'achat nutritionnel d'un dollar jamaïcain a chuté en 14 mois, passant de 2 232 calories de farine à seulement 1 443 ; de 1 649 calories de riz à 905 ; de 1 037 calories de lait concentré à 508 ; et de 220 calories de poulet à 174.
- En raison de l'ajustement structurel, les salaires réels mexicains ont diminué de plus de 75% dans les années 1980. En 1986, environ 70 % des Mexicains à faible revenu avaient "pratiquement cessé de manger du riz, des œufs, des fruits, des légumes et du lait (sans parler de la viande ou du poisson)", alors que leur gouvernement versait 27 millions de dollars par jour - 18 750 dollars par minute - en intérêts à ses créanciers. Dans les années 1990, "une famille de quatre personnes au salaire minimum (qui représentait 60 % de la population active occupée) ne pouvait acheter que 25 % de ses besoins essentiels".
- En Afrique subsaharienne, le PNB par habitant "a chuté régulièrement de 624 dollars en 1980 à 513 dollars en 1998... la production alimentaire par habitant en Afrique était de 105 en 1980 mais de 92 en 1997... et les importations alimentaires ont augmenté de façon étonnante de 65% entre 1988 et 1997."
Ces exemples, bien que tragiques, ne donnent qu'une image réduite et fragmentaire de l'impact délétère que les politiques de la Banque et du Fonds ont eu sur la santé des pauvres du monde.
En moyenne, chaque année, de 1980 à 1985, 47 pays du tiers monde ont suivi des programmes d'ajustement structurel parrainés par le FMI, et 21 pays en développement ont obtenu des prêts d'ajustement structurel ou sectoriel de la Banque mondiale. Au cours de cette même période, 75 % de tous les pays d'Amérique latine et d'Afrique ont connu une baisse du revenu par habitant et du bien-être des enfants.
La baisse du niveau de vie est logique si l'on considère que les politiques de la Banque et du Fonds ont sculpté les sociétés pour qu'elles se concentrent sur les exportations au détriment de la consommation, tout en vidant de leur substance la sécurité alimentaire et les services de santé.
Pendant l'ajustement structurel du FMI, les salaires réels dans des pays comme le Kenya ont diminué de plus de 40 %. Après avoir reçu des milliards de crédits de la Banque et du Fonds, la production alimentaire par habitant en Afrique a chuté de près de 20 % entre 1960 et 1994. Pendant ce temps, les dépenses de santé dans les "pays programmés par le FMI et la Banque mondiale" ont diminué de 50 % au cours des années 1980.
Lorsque la sécurité alimentaire et les soins de santé s'effondrent, les gens meurent.
Des articles de 2011 et 2013 ont montré que les pays ayant contracté un prêt d'ajustement structurel présentaient des niveaux de mortalité infantile plus élevés que ceux qui ne l'avaient pas fait. Une analyse de 2017 était "pratiquement unanime pour trouver une association néfaste entre l'ajustement structurel et les résultats en matière de santé infantile et maternelle." Une étude de 2020 a examiné les données de 137 pays en développement entre 1980 et 2014 et a constaté que "les réformes d'ajustement structurel réduisent l'accès au système de santé et augmentent la mortalité néonatale." Un document de 2021 a conclu que l'ajustement structurel joue "un rôle important dans la perpétuation des handicaps et des décès évitables."
Il est impossible de faire un décompte complet du nombre de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont été tués à cause des politiques d'austérité de la Banque et du Fonds.
Le défenseur de la sécurité alimentaire Davidson Budhoo a affirmé que six millions d'enfants sont morts chaque année en Afrique, en Asie et en Amérique latine entre 1982 et 1994 à cause de l'ajustement structurel. Cela mettrait le bilan de la Banque et du Fonds dans la même fourchette que les décès causés par Staline et Mao.
Est-ce possible ? Personne ne le saura jamais. Mais en examinant les données, nous pouvons commencer à en avoir une idée.
Des recherches menées au Mexique - un pays typique en termes d'implication constante de la Banque et du Fonds dans le passé - montrent que pour chaque baisse de 2 % du PIB, le taux de mortalité augmente de 1 %.
Considérons maintenant qu'en raison de l'ajustement structurel, le PIB de douzaines de pays du tiers monde a subi, entre les années 1960 et 1990, des contractions à deux chiffres. Malgré une croissance démographique massive, nombre de ces économies ont stagné ou se sont contractées sur des périodes de 15 à 25 ans. Autrement dit, les politiques de la Banque et du Fonds ont probablement tué des dizaines de millions de personnes.
Quel que soit le bilan final, il y a deux certitudes : premièrement, il s'agit de crimes contre l'humanité, et deuxièmement, aucun responsable de la Banque ou du Fonds n'ira jamais en prison. Il n'y aura jamais de responsabilité ni de justice.
La réalité inéluctable est que des millions de personnes sont mortes trop jeunes afin de prolonger et d'améliorer la vie de millions d'autres personnes. Il est bien sûr vrai qu'une grande partie du succès de l'Occident est due aux valeurs des Lumières telles que l'État de droit, la liberté d'expression, la démocratie libérale et le respect national des droits de l'homme. Mais la vérité non dite est qu'une grande partie du succès de l'Occident est aussi le résultat du vol des ressources et du temps des pays pauvres.
La richesse et le travail volés au tiers monde resteront impunis, mais ils sont visibles aujourd'hui, incrustés à jamais dans l'architecture, la culture, la science, la technologie et la qualité de vie du monde développé. La prochaine fois que vous visiterez Londres, New York, Tokyo, Paris, Amsterdam ou Berlin, l'auteur vous suggère de vous promener et de vous arrêter devant une vue particulièrement impressionnante ou pittoresque de la ville pour réfléchir à tout cela. Comme le dit le vieil adage, "il faut traverser l'obscurité pour atteindre la lumière".
XVI. Un Trillion De Dollars : La Banque et Le Fonds Lans Le Monde Post-Covid
"Nous sommes tous dans le même bateau".
- Christine Lagarde, ancienne directrice générale du FMI
La politique de la Banque et du Fonds à l'égard des pays en développement n'a pas beaucoup changé au cours des dernières décennies. Bien sûr, il y a eu quelques ajustements superficiels, comme l'initiative "Pays pauvres très endettés" (PPTE)", qui permet à certains gouvernements de bénéficier d'un allégement de la dette. Mais sous ce nouveau langage, même les pays les plus pauvres parmi les pauvres doivent encore procéder à des ajustements structurels. Ils ont simplement été rebaptisés "stratégie de réduction de la pauvreté".
Les mêmes règles s'appliquent toujours : en Guyane, par exemple, "le gouvernement a décidé au début de l'année 2000 d'augmenter les salaires des fonctionnaires de 3,5 %, après une baisse du pouvoir d'achat de 30 % au cours des cinq années précédentes." Le FMI a immédiatement menacé de retirer le Guyana de la nouvelle liste des PPTE. "Après quelques mois, le gouvernement a dû faire marche arrière".
Les mêmes dévastations à grande échelle se produisent encore. Dans un rapport de 2015 du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), il était par exemple estimé que 3,4 millions de personnes avaient été déplacées au cours de la décennie précédente par des projets financés par la Banque. Aux anciens jeux comptables, destinés à exagérer le bien fait par l'aide, s'ajoutent de nouveaux jeux.
Le gouvernement américain applique une décote de 92 % à la dette des pays pauvres très endettés, et pourtant les autorités américaines incluent la valeur nominale de l'allègement de la dette dans leurs chiffres de "l'APD" (aide publique au développement). Autrement dit, elles exagèrent considérablement le volume de leur aide. Le Financial Times a affirmé qu'il s'agit de "l'aide qui n'existe pas" et a fait valoir que "l'annulation de la dette commerciale officielle ne devrait pas être considérée comme une aide".
S'il est vrai qu'il y a eu de grandes transformations à la Banque et au Fonds ces dernières années, ces changements n'ont pas porté sur la manière dont les institutions essaient de façonner les économies des pays emprunteurs, mais plutôt sur le fait qu'elles ont concentré leurs efforts sur des nations plus proches du cœur économique du monde.
"Selon pratiquement tous les critères", observe une étude du NBER, "les programmes post-2008 du FMI en faveur de plusieurs économies européennes sont les plus importants des 70 ans d'histoire du FMI."
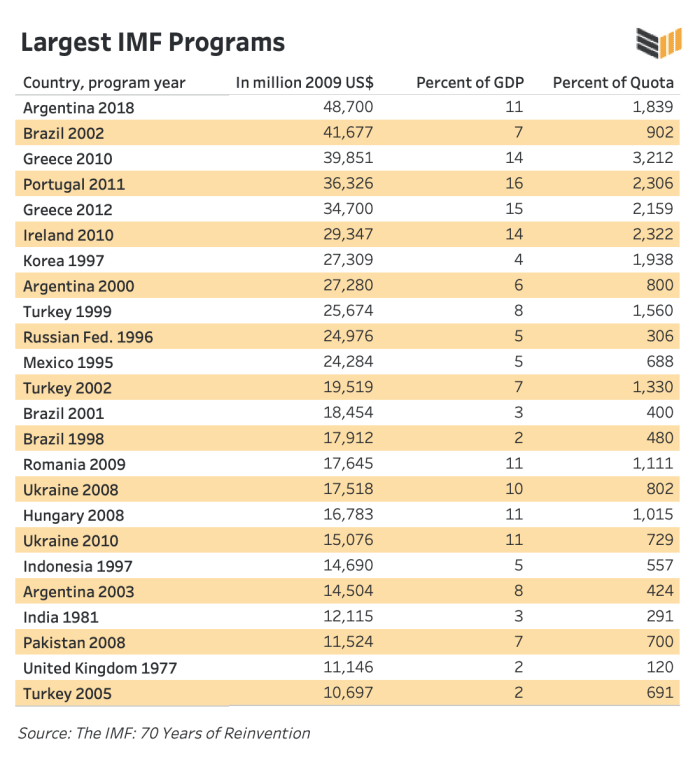
"Les engagements du FMI en pourcentage du PIB mondial, explique l'étude, ont atteint un niveau record lorsque la crise de la dette européenne a commencé à se dénouer." L'Islande a entamé un programme du FMI en 2008, suivie par la Grèce, l'Irlande et le Portugal.
Le renflouement de la Grèce par le FMI s'est élevé à la somme faramineuse de 375 milliards de dollars. En juillet 2015, "le mécontentement populaire a conduit à un vote négatif lors d'un référendum sur l'acceptation ou non des conditions de prêt du FMI, qui comprenaient une augmentation des impôts, une baisse des retraites et d'autres dépenses, et la privatisation d'industries."
En fin de compte, cependant, la voix du peuple grec n'a pas été entendue puisque "le gouvernement a ensuite ignoré les résultats et accepté les prêts."
Le Fonds a utilisé en Grèce et dans d'autres pays européens à faible revenu le même livre de jeu que celui qu'il utilise partout dans le monde en développement depuis des décennies : briser les normes démocratiques pour fournir des milliards aux élites, avec une austérité pour les masses.
Au cours des deux dernières années, la Banque et le Fonds ont injecté des centaines de milliards de dollars dans des pays ayant subi des blocages gouvernementaux et des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Plus de prêts ont été accordés en un temps plus court que jamais auparavant.
Même à la fin de l'année 2022, alors que les taux d'intérêt continuent de grimper, la dette des pays pauvres ne cesse d'augmenter, et le montant qu'ils doivent aux pays riches ne cesse de croître. L'histoire rime, et les visites du FMI dans des dizaines de pays nous rappellent le début des années 1980, lorsqu'une énorme bulle d'endettement a été éclatée par les politiques de la Réserve fédérale. Il s'en est suivi la pire dépression dans le tiers monde depuis les années 30.
Nous pouvons espérer que cela ne se reproduira pas, mais étant donné les efforts de la Banque et du Fonds pour endetter les pays pauvres comme jamais auparavant, et étant donné que le coût des emprunts augmente de manière historique, nous pouvons prédire que cela se reproduira.
Et même lorsque l'influence de la Banque et du Fonds diminue, le Parti communiste chinois (PCC) commence à intervenir. Au cours de la dernière décennie, la Chine a tenté d'imiter la dynamique du FMI et de la Banque mondiale par le biais de ses propres institutions de développement et de son initiative "Belt and Road".
Comme l'écrit le géostratège indien Brahma Chellaney, "par le biais de son initiative "une ceinture, une route", d'une valeur de 1000 milliards de dollars, la Chine soutient des projets d'infrastructure dans des pays en développement situés à des endroits stratégiques, souvent en accordant d'énormes prêts à leurs gouvernements. En conséquence, les pays se retrouvent pris au piège de la dette, ce qui les rend vulnérables à l'influence de la Chine... Les projets que la Chine soutient ne sont souvent pas destinés à soutenir l'économie locale, mais à faciliter l'accès de la Chine aux ressources naturelles, ou à ouvrir le marché à ses produits d'exportation bon marché et de mauvaise qualité. Dans de nombreux cas, la Chine envoie même ses propres ouvriers du bâtiment, ce qui minimise le nombre d'emplois locaux créés."
La dernière chose dont le monde a besoin, c'est d'une autre dynamique de drainage des banques et des fonds, qui ne fait que retirer des ressources aux pays pauvres pour les affecter à la dictature génocidaire de Pékin. Il est donc bon de voir que le PCC a des difficultés dans ce domaine. Il essaie de faire croître sa Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures de plus de 10 milliards de dollars par an, mais il rencontre divers problèmes avec les projets qu'il a financés dans le monde en développement. Certains gouvernements, comme celui du Sri Lanka, ne peuvent tout simplement pas rembourser. Comme le PCC ne peut pas frapper la monnaie de réserve mondiale, il doit en fait absorber la perte. Pour cette raison, elle ne sera probablement pas en mesure de s'approcher du volume de prêts du système dirigé par les États-Unis, l'Europe et le Japon.
Ce qui est certainement une bonne chose : les prêts du PCC ne sont peut-être pas assortis de conditions d'ajustement structurel onéreuses, mais ils ne tiennent certainement pas compte des droits de l'homme. En fait, le PCC a contribué à protéger un client de la Ceinture et la Route - le président sri-lankais Mahinda Rajapaksa - contre des allégations de crimes de guerre aux Nations unies. Si l'on examine ses projets en Asie du Sud-Est (où elle épuise les minerais et le bois birmans et érode la souveraineté pakistanaise) et en Afrique subsaharienne (où elle extrait une énorme quantité de terres rares), on constate qu'il s'agit en grande partie du même type de vol de ressources et de tactiques de contrôle géopolitique pratiqués par les puissances coloniales depuis des siècles, juste habillés d'un nouveau type de vêtements.
Il n'est pas certain que la Banque et le Fonds considèrent le PCC comme un mauvais acteur. Après tout, Wall Street et la Silicon Valley ont tendance à être assez amicaux avec les pires dictateurs du monde. La Chine reste un créancier de la Banque et du Fonds : son adhésion n'a jamais été remise en question, malgré le génocide du peuple ouïghour. Tant que le PCC n'entrave pas la réalisation des objectifs généraux, la Banque et le Fonds n'y voient probablement pas d'inconvénient. Il y a assez de butin pour tout le monde.
XVII. D'Arusha à Accra
"Ceux qui détiennent le pouvoir contrôlent l'argent"
- Arusha Delegates, 1979
En 1979, les pays en développement se sont réunis dans la ville tanzanienne d'Arusha pour concevoir un plan alternatif à l'ajustement structurel dirigé par le FMI et la Banque mondiale, qui les avait laissés avec des montagnes de dettes et très peu d'influence sur l'avenir de l'économie mondiale.
"Ceux qui détiennent le pouvoir contrôlent l'argent", ont écrit les délégués : "Ceux qui gèrent et contrôlent l'argent détiennent le pouvoir. Un système monétaire international est à la fois une fonction et un instrument des structures de pouvoir dominantes."
Comme l'écrit Stefan Eich dans "The Currency Of Politics", "l'accent mis par l'Initiative d'Arusha sur le fardeau des déséquilibres hiérarchiques du système monétaire international était une tentative puissante d'insister sur la nature politique de l'argent en contrant les prétentions à une expertise technique neutre affirmées par les docteurs de l'argent du Fonds".
"Le FMI pouvait prétendre à une position neutre, objective et scientifique", écrit Eich, "mais toutes les preuves scientifiques, y compris la documentation interne du Fonds, montraient le contraire. Le Fonds était, en fait, profondément idéologique dans sa façon de présenter le sous-développement comme un manque de marchés privés, mais appliquait systématiquement deux poids deux mesures en ignorant les contrôles de marché similaires dans les pays 'développés'."
Cela résonne avec ce que Cheryl Payer a observé, à savoir que les économistes de la Banque et du Fonds "ont érigé une mystique autour de leur sujet qui intimidait même les autres économistes."
"Ils se représentent, dit-elle, comme des techniciens hautement qualifiés qui déterminent le "bon" taux de change et le "bon" montant de la création monétaire sur la base de formules complexes. Ils nient la signification politique de leur travail."
Comme la plupart des discours de gauche sur la Banque et le Fonds, les critiques formulées à Arusha étaient pour la plupart ciblées : les institutions étaient exploitantes, et enrichissaient leurs créanciers aux dépens des pays pauvres. Mais les solutions d'Arusha manquaient la cible : planification centrale, ingénierie sociale et nationalisation.
Les délégués d'Arusha ont préconisé l'abolition de la Banque et du Fonds, ainsi que l'annulation des dettes odieuses : des objectifs peut-être nobles mais totalement irréalistes. Au-delà, leur meilleur plan d'action était de "transférer le pouvoir entre les mains des gouvernements locaux" - une piètre solution étant donné que la grande majorité des pays du tiers monde sont des dictatures.
Pendant des décennies, la population des pays en développement a souffert du fait que leurs dirigeants hésitaient entre vendre leur pays aux multinationales et l'autoritarisme socialiste. Les deux options étaient destructrices.
C'est le piège dans lequel s'est retrouvé le Ghana depuis son indépendance de l'Empire britannique. Le plus souvent, les autorités ghanéennes, quelle que soit leur idéologie, ont choisi l'option d'emprunter à l'étranger.
Le Ghana a une histoire stéréotypée avec la Banque et le Fonds : les dirigeants militaires ont pris le pouvoir par un coup d'État uniquement pour imposer l'ajustement structurel du FMI ; les salaires réels ont chuté de 82% entre 1971 et 1982, les dépenses de santé publique ont diminué de 90% et le prix de la viande a augmenté de 400% au cours de la même période ; les emprunts ont servi à construire d'énormes projets de type éléphant blanc comme le barrage d'Akosombo, qui a alimenté une usine d'aluminium appartenant aux États-Unis au détriment d'une population plus nombreuse. La création du plus grand lac artificiel du monde a provoqué la cécité des rivières et la paralysie de plus de 150,000 personnes. Enfin, 75 % des forêts tropicales du pays ont été détruites alors que les industries du bois, du cacao et des minéraux ont connu un essor considérable et que la production alimentaire nationale s'est effondrée. Le Ghana a reçu une aide de 2,2 milliards de dollars en 2022, mais la dette atteint le niveau record de 31 milliards de dollars, contre 750 millions de dollars il y a 50 ans.
Depuis 1982, sous les "conseils" du FMI, le cedi ghanéen a été dévalué de 38000 %. L'un des principaux résultats de l'ajustement structurel a été, comme ailleurs dans le monde, l'accélération de l'extraction des ressources naturelles du Ghana. Entre 1990 et 2002, par exemple, le gouvernement n'a reçu que 87,3 millions de dollars sur les 5,2 milliards de dollars d'or extraits du sol ghanéen : en d'autres termes, 98,4 % des bénéfices de l'extraction de l'or au Ghana sont allés aux étrangers.
Comme le dit le manifestant ghanéen Lyle Pratt, "le FMI n'est pas là pour faire baisser les prix, il n'est pas là pour s'assurer que nous construisons des routes - ce n'est pas son affaire et il s'en moque tout simplement... La préoccupation première du FMI est de s'assurer que nous construisons la capacité de payer nos prêts, pas de nous développer."
2022 ressemble à une rediffusion. Le cedi ghanéen a été l'une des monnaies les moins performantes du monde cette année, perdant 48,5 % de sa valeur depuis janvier. Le pays est confronté à une crise de la dette et, comme dans les décennies passées, est contraint de donner la priorité au remboursement de ses créanciers plutôt qu'à l'investissement dans son propre peuple.
En octobre, il y a quelques semaines à peine, le pays a reçu sa dernière visite du FMI. Si un prêt est finalisé, ce serait le 17e prêt du FMI pour le Ghana depuis le coup d'État militaire de 1966 soutenu par la CIA. Cela représente 17 couches d'ajustement structurel.
Une visite du FMI est un peu comme une visite de la Faucheuse - elle ne peut signifier qu'une chose : plus d'austérité, de douleur et - sans exagération - de mort. Peut-être que les riches et les personnes bien connectées peuvent s'en sortir indemnes ou même s'enrichir, mais pour les pauvres et les classes laborieuses, la dévaluation de la monnaie, la hausse des taux d'intérêt et la disparition du crédit bancaire sont dévastatrices. Ce n'est pas le Ghana de 1973 que Cheryl Payer a décrit pour la première fois dans "The Debt Trap" : nous sommes 50 ans plus tard, et le piège est 40 fois plus profond.
Mais il y a peut-être une lueur d'espoir.
Du 5 au 7 décembre 2022, dans la capitale ghanéenne d'Accra, il y aura une visite d'un genre différent. Au lieu de créanciers cherchant à faire payer des intérêts au peuple ghanéen et à dicter leurs industries, les conférenciers et les organisateurs de l'Africa Bitcoin Conference se réunissent pour partager des informations, des outils open-source et des tactiques de décentralisation sur la façon de construire une activité économique qui échappe au contrôle des gouvernements corrompus et des multinationales étrangères.
Farida Nabourema est l'organisatrice principale. Elle est pro-démocratie, pro-pauvre, anti-banque et fonds, anti-autoritaire et pro-bitcoin.
"La vraie question", a écrit un jour Cheryl Payer, "est de savoir qui contrôle le capital et la technologie qui sont exportés vers les pays les plus pauvres."
On peut arguer que le bitcoin en tant que capital et en tant que technologie est exporté au Ghana et au Togo : il n'est certainement pas né là-bas. Mais on ne sait pas vraiment où il est apparu. Personne ne sait qui l'a créé. Et aucun gouvernement ou société ne peut le contrôler.
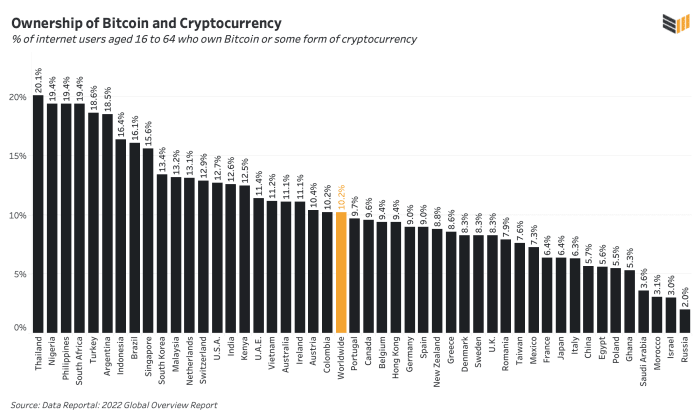
Pendant l'étalon-or, la violence du colonialisme a corrompu un étalon monétaire neutre. Dans le monde post-colonial, un étalon monétaire fiat - soutenu par la Banque et le Fonds - a corrompu une structure de pouvoir post-coloniale. Pour le tiers monde, un monde post-colonial et post-fiat sera peut-être le bon mélange.
Les partisans de la théorie de la dépendance, comme Samir Amin, se sont réunis lors de conférences comme celle d'Arusha et ont appelé à une "séparation" des pays pauvres et des pays riches. L'idée était la suivante : la richesse des pays riches n'était pas seulement attribuable à leurs démocraties libérales, à leurs droits de propriété et à leurs environnements entrepreneuriaux, mais aussi au vol des ressources et de la main-d'œuvre des pays pauvres. Enrayer ce vol, c'est donner un coup de pouce aux pays pauvres. Amin a prédit que "la construction d'un système au-delà du capitalisme devra commencer dans les zones périphériques". Si nous sommes d'accord avec Allen Farrington pour dire que le système monétaire actuel n'est pas le capitalisme et que le système actuel du dollar est profondément défectueux, alors Amin avait peut-être raison. Il est plus probable qu'un nouveau système émerge à Accra, et non à Washington ou à Londres.
Comme l'écrit Saifedean Ammous, "le monde en développement est composé de pays qui n'avaient pas encore adopté les technologies industrielles modernes au moment où un système monétaire mondial inflationniste a commencé à remplacer un système relativement sain en 1914. Ce système monétaire mondial dysfonctionnel a continuellement compromis le développement de ces pays en permettant aux gouvernements locaux et étrangers d'exproprier la richesse produite par leur population."
En d'autres termes, les pays riches se sont industrialisés avant d'avoir la monnaie fiduciaire et les pays pauvres ont eu la monnaie fiduciaire avant de s'industrialiser. Selon M. Nabourema et d'autres organisateurs de l'Africa Bitcoin Conference, la seule façon de briser le cycle de la dépendance pourrait être de transcender la monnaie fiduciaire.
XVIII. Une Lueur D'espoir
"Le problème fondamental de la monnaie conventionnelle est toute la confiance qui est nécessaire pour qu'elle fonctionne. Il faut faire confiance à la banque centrale pour qu'elle ne dévalorise pas la monnaie, mais l'histoire des monnaies fiduciaires est pleine de violations de cette confiance."
- Satoshi Nakamoto
Quelle que soit la réponse à la pauvreté dans le tiers-monde, nous savons que ce n'est pas plus de dettes. "Les pauvres du monde", conclut Cheryl Payer, "n'ont pas besoin d'une autre "banque", aussi bénigne soit-elle. Ils ont besoin d'un travail décemment rémunéré, d'un gouvernement réactif, de droits civils et d'autonomie nationale."
Pendant sept décennies, la Banque mondiale et le FMI ont été les ennemis de ces quatre éléments.
Pour l'avenir, dit Payer, "la tâche la plus importante pour ceux qui, dans les pays riches, se soucient de la solidarité internationale, est de lutter activement pour mettre fin au flux de l'aide étrangère." Le problème est que le système actuel est conçu et incité à maintenir ce flux. La seule façon d'apporter un changement est de procéder à un changement total de paradigme.
Nous savons déjà que Bitcoin peut aider les individus des pays en développement à acquérir une liberté financière personnelle et à échapper aux systèmes brisés qui leur sont imposés par leurs dirigeants corrompus et les institutions financières internationales. C'est ce qui sera accéléré à Accra le mois prochain, contre les conceptions de la Banque et du Fonds. Mais le bitcoin peut-il réellement changer la dynamique centre-périphérie de la structure du pouvoir et des ressources dans le monde ?
Nabourema est optimiste et ne comprend pas pourquoi les gauchistes en général condamnent ou ignorent le bitcoin.
"Un outil qui est capable de permettre aux gens de construire et d'accéder à la richesse indépendamment des institutions de contrôle peut être considéré comme un projet de gauche", dit-elle. "En tant que militante qui croit que les citoyens devraient être payés dans des monnaies qui valorisent réellement leur vie et leurs sacrifices, le bitcoin est une révolution populaire."
"Je trouve douloureux, dit-elle, qu'un agriculteur d'Afrique subsaharienne ne gagne que 1% du prix du café sur le marché mondial. Si nous pouvons arriver à un stade où les agriculteurs peuvent vendre leur café sans tant d'institutions intermédiaires plus directement aux acheteurs, et être payés en bitcoins, vous pourriez imaginer la différence que cela ferait dans leur vie."
"Aujourd'hui, dit-elle, nos pays du Sud continuent d'emprunter de l'argent en dollars américains, mais au fil du temps, nos monnaies se déprécient et perdent de la valeur, et nous finissons par devoir effectuer deux ou trois fois le paiement initialement promis pour rembourser nos créanciers."
"Maintenant, imaginez", dit-elle, "si nous arrivons à un stade, dans 10 ou 20 ans, où le bitcoin est la monnaie mondiale acceptée pour les affaires dans le monde entier, où chaque nation doit emprunter en bitcoin et dépenser en bitcoin et où chaque nation doit payer ses dettes en bitcoin. Dans ce monde, alors les gouvernements étrangers ne peuvent pas exiger que nous les remboursions en devises que nous devons gagner mais qu'ils peuvent simplement imprimer ; et ce n'est pas parce qu'ils décident d'augmenter leurs taux d'intérêt que cela va automatiquement mettre en péril la vie de millions ou de milliards de personnes dans nos pays."
"Bien sûr", ajoute Nabourema, "Bitcoin va venir avec des problèmes comme toute innovation. Mais la beauté de la chose est que ces problèmes peuvent être améliorés grâce à une collaboration pacifique et mondiale. Il y a 20 ans, personne ne savait quelles choses étonnantes l'internet nous permet de faire aujourd'hui. Personne ne peut dire quelles choses étonnantes le bitcoin nous permettra de faire dans 20 ans."
"La voie à suivre, dit-elle, est un réveil des masses : qu'elles comprennent les tenants et aboutissants du fonctionnement du système et qu'elles comprennent qu'il existe des alternatives. Nous devons être dans une position où les gens peuvent récupérer leur liberté, où leur vie n'est pas contrôlée par des autorités qui peuvent confisquer leur liberté à tout moment sans conséquences. Petit à petit, nous nous rapprochons de cet objectif avec le bitcoin."
"Puisque l'argent est le centre de tout dans notre monde, poursuit Nabourema, le fait que nous soyons maintenant en mesure d'obtenir une indépendance financière est tellement important pour les gens de nos pays, alors que nous cherchons à récupérer nos droits dans tous les domaines et secteurs."
Dans une interview réalisée pour cet article, Jeff Booth, défenseur de la déflation, explique qu'à mesure que le monde se rapproche d'une norme bitcoin, la Banque et le Fonds seront moins susceptibles d'être des créanciers, et plus susceptibles d'être des co-investisseurs, des partenaires, ou simplement des concédants. Comme les prix baissent au fil du temps, cela signifie que la dette devient plus chère et plus difficile à rembourser. Et si l'imprimante à billets américaine était fermée, il n'y aurait plus de renflouement. Dans un premier temps, suggère-t-il, la Banque et le Fonds essaieront de continuer à prêter, mais pour la première fois, ils perdront de grosses sommes d'argent, les pays faisant librement défaut en passant au standard bitcoin. Ils pourraient donc envisager de co-investir à la place, ce qui leur permettrait de s'intéresser davantage au succès réel et à la durabilité des projets qu'ils soutiennent, le risque étant plus équitablement partagé.
L'extraction de bitcoins est un autre domaine de changement potentiel. Si les pays pauvres peuvent échanger leurs ressources naturelles contre de l'argent sans avoir à traiter avec des puissances étrangères, alors peut-être que leur souveraineté peut se renforcer, au lieu de s'éroder. Grâce au minage, les vastes quantités d'énergie fluviale, d'hydrocarbures, de soleil, de vent, de chaleur au sol et d'OTEC offshore des marchés émergents pourraient être converties directement en monnaie de réserve mondiale sans autorisation. Cela n'a jamais été possible auparavant. Le piège de la dette semble vraiment inéluctable pour la plupart des pays pauvres, continuant de croître chaque année. Peut-être que l'investissement dans des réserves, des services et des infrastructures en bitcoins anti-fiat est un moyen d'en sortir et de riposter.
Selon Booth, le bitcoin peut court-circuiter l'ancien système qui a subventionné les pays riches au détriment des salaires des pays pauvres. Dans cet ancien système, la périphérie devait être sacrifiée pour protéger le noyau. Dans le nouveau système, la périphérie et le centre peuvent travailler ensemble. Actuellement, dit-il, le système du dollar américain maintient les gens dans la pauvreté par la déflation des salaires dans la périphérie. Mais en égalisant la monnaie et en créant une norme neutre pour tous, on crée une dynamique différente. Avec une norme monétaire unique, les taux de travail seraient nécessairement rapprochés, au lieu d'être éloignés. Selon Booth, nous n'avons pas de mots pour décrire une telle dynamique, car elle n'a jamais existé : il suggère une "coopération forcée".
Booth décrit la capacité des États-Unis à émettre instantanément n'importe quel montant de dette supplémentaire comme un "vol en monnaie de base". Les lecteurs connaissent peut-être l'effet Cantillon, selon lequel les personnes les plus proches de l'imprimante à billets profitent de l'argent frais tandis que les plus éloignées souffrent. Eh bien, il s'avère qu'il existe également un effet Cantillon mondial, où les États-Unis bénéficient de l'émission de la monnaie de réserve mondiale et où les pays pauvres souffrent.
"Un standard bitcoin", dit Booth, "met fin à cela".
Quelle part de la dette mondiale est odieuse ? Il y a des milliers de milliards de dollars de prêts créés au gré des dictateurs et des institutions financières supranationales non élues, avec zéro consentement des personnes du côté de l'emprunt. La chose morale à faire serait d'annuler cette dette, mais bien sûr, cela n'arrivera jamais car les prêts existent en fin de compte en tant qu'actifs dans les bilans des créanciers de la Banque et du Fonds. Ils préféreront toujours garder les actifs et simplement créer de nouvelles dettes pour payer les anciennes.
Le "put" du FMI sur la dette souveraine crée la plus grosse bulle de toutes : plus grosse que la bulle Internet, plus grosse que la bulle des prêts hypothécaires à risque, et plus grosse encore que la bulle COVID alimentée par les mesures de relance. Le démantèlement de ce système sera extrêmement douloureux, mais c'est la bonne chose à faire. Si la dette est la drogue, que la Banque et le Fonds sont les dealers et que les gouvernements des pays en développement sont les accros, il est peu probable que l'une ou l'autre des parties veuille s'arrêter. Mais pour guérir, les toxicomanes doivent aller en cure de désintoxication. Le système fiat rend cela pratiquement impossible. Dans le système Bitcoin, on peut en arriver au point où le patient n'a pas d'autre choix.
Comme le dit Saifedean Ammous dans une interview pour cet article, aujourd'hui, si les dirigeants du Brésil veulent emprunter 30 milliards de dollars et que le Congrès américain est d'accord, l'Amérique peut claquer des doigts et allouer les fonds par le biais du FMI. C'est une décision politique. Mais, dit-il, si nous nous débarrassons de l'imprimeur de monnaie, alors ces décisions deviennent moins politiques et commencent à ressembler à la prise de décision plus prudente d'une banque qui sait qu'aucun renflouement ne viendra.
Au cours des 60 dernières années de domination des banques et des fonds, d'innombrables tyrans et kleptocrates ont été renfloués - à l'encontre de tout bon sens financier - afin que les ressources naturelles et la main-d'œuvre de leurs nations puissent continuer à être exploitées par les pays centraux. Cela était possible parce que le gouvernement au cœur même du système pouvait imprimer la monnaie de réserve.
Mais dans un standard bitcoin, Ammous se demande qui va faire ces prêts à haut risque de plusieurs milliards de dollars en échange d'un ajustement structurel ?
"Vous," demande-t-il, "et les bitcoins de qui ?"
Sauf indication contraire, le contenu de cet article est sous licence CC BY-SA 4.0

Sovereign Monk
Bitcoin, Privacy & Individual Sovereignty Maximalist | Founder of European Bitcoiners - for Free and Open Bitcoin Education.
follow me :




Related Posts
Zakaj EU omejuje plačila iz lastniških denarnic preko Lightning omrežja in kaj je s tem dosegla
Mar 16, 2025
What Caused the Recent Drop in Bitcoin's Price - August 2024?
Aug 07, 2024
Bitcoin: Empowering Prague's Historic Fight for Freedom
May 13, 2024